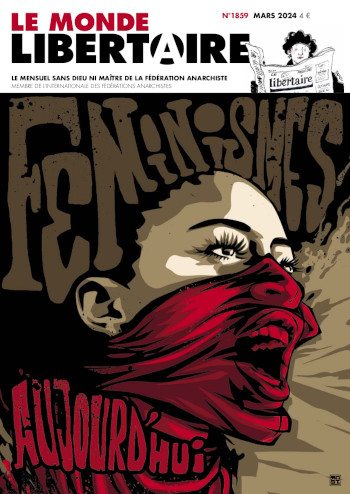La guerre qui n’en finit pas : entretien avec Gael Baryin
mis en ligne le 4 décembre 2014
Le Monde libertaire : Tu n’es pas un professionnel, spécialiste de la question, ni universitaire ni journaliste. Peux-tu nous rappeler, en quelques mots, ce que tu racontes d’ailleurs au début de ton livre, comment tu as été amené à rencontrer les Touaregs ?Gael Baryin : Parti en Afrique vers l’âge de 20 ans en voiture avec un ami, nous nous sommes égarés dans le Sahara… Ça a été un moment disons assez éprouvant. C’était en 1978. Après avoir retrouvé notre route par un hasard presque miraculeux, les premiers êtres humains que nous avons croisés étaient des nomades touaregs. Nous passâmes quelques jours avec eux. À force d’y retourner régulièrement, j’ai fini par considérer ce bout de désert à l’extrême nord du Mali, la région de Kidal, comme mon second pays.
M. L. : Semaine après semaine l’actualité nous rappelle qu’une guerre de basse intensité se passe dans cette région du monde. Un soldat français meurt dans tel ou tel massif. Un leader djihadiste apparaît, puis disparaît. Personne ne comprend plus rien à ce jeu d’ombres. Avec toi, essayons de faire, aujourd’hui, le point sur la question. Peux-tu nous éclairer sur la ou les formes d’islam pratiquées par les populations du désert ?
G.B. : La question n’est pas tant celle de la forme que prend l’islam local – il est traditionnellement sunnite modéré – que pourquoi, à un moment donné de leur histoire, certains combattants touaregs ont adopté une forme d’islam radical qui leur était encore inconnue il y a deux ou trois ans, ont pu combattre en son nom. Il faut considérer le conflit au nord du Mali comme un conflit multidimensionnel à plusieurs niveaux de lectures qui s’interpénètrent, ce qui le rend si difficile à comprendre d’ici.
M. L. : Nous reviendrons plus loin sur cette attirance pour ce type de radicalisme qui est partagé dans beaucoup d’autres endroits. J’aimerais que tu nous dises dans quelle mesure, en arrière-plan, il n’y aurait pas un antagonisme archaïque, que l’on retrouve bien ailleurs, entre nomade et sédentaire.
G. B. : Non, pas du tout. Les conflits entre nomades et sédentaires, portant essentiellement sur la gestion des terres et l’accès à l’eau, se gèrent depuis des siècles par des systèmes internes de négociations. L’une des dimensions – mais de loin pas la seule – du conflit est politique, entre un sud qui détient les outils du pouvoir et un nord, autant nomade « blanc » (Touaregs, Arabes) que sédentaire « noir » (Songhaïs, Peulhs) qui se sent oublié, économiquement, culturellement et politiquement. La frontière tracée en avril 2012 entre l’Azawad (la moitié nord) et le Mali (la moitié sud) passait très en dessous de Douentza, englobant numériquement parlant beaucoup plus de sédentaires que de nomades. Réduire ce conflit à quelques signes facilement identifiables (activités, modes de vie, couleurs de peau), c’est passer à côté de ses causes.
M. L. : L’antagonisme sédentaire-nomade s’exprime la plupart du temps, plus ou moins violemment du côté des sédentaires, comme c’est le cas en France vis-à-vis des Roms qui ne sont plus, pour la plupart, des nomades mais le restent dans l’imaginaire social. Dans le cas du Mali, cela a-t-il une existence dans les rapports du pouvoir du sud avec le nord ?
G. B. : Il y a de toute évidence de part et d’autre un racisme réparti de façon homogène du nord au sud, mais basé sur des considérations différentes. Il est à la fois social et culturel. Il n’est pas particulièrement lié au nomadisme en lui-même, en tant que mode de vie, mais plutôt axé sur des pratiques sociales et culturelles qui sont objet de mépris d’un côté comme de l’autre.
M. L. : Je ne pense pas que l’inimitié archaïque entre sédentaires et nomades relève du racisme. Mais cela peut faire l’objet d’un autre débat. Ta description rapide et pertinente du Nord-Mali démontre que l’image que nous avons d’un nord homogène ethniquement est fausse. Peut-on en déduire que tous les Touaregs ne sont pas nomades, et que les Peulhs, connus pour leurs activités de pasteurs, nomadisent en suivant leurs troupeaux ? Les Songhaïs, pour ce que j’en sais, seraient plutôt agriculteurs, donc sédentaires par obligation. Au milieu du XVIIIe siècle, un théoricien suisse du droit international, Emer de Vattel, avança qu’une terre qui n’est pas cultivée est libre de droit. Il créa le concept de Terra nullius qui permit par exemple aux Britanniques de conquérir à leur profit l’Australie puisqu’elle était vide.
G. B. : Plus l’on monte vers le nord, plus le nomadisme est majoritaire. Ceci est directement lié aux conditions environnementales : plus l’on remonte vers le désert, moins il y a d’eau et de pluies, et donc de maraîchage. Les Touaregs au Mali ne se présentent pas en bloc homogène, pas plus que les autres groupes sociaux du nord d’ailleurs. Il y a des différences notables entre par exemple ceux de Kidal et ceux de Gao ou de Ménaka, y compris jusque dans la langue. « Touaregs » est une appellation exogène. Ils s’autodésignent comme Kel Tamasheq : « Ceux qui parlent la langue ». Ils se divisent en plusieurs sous-groupes (tribus, fractions) qui, selon le contexte, le moment ou l’enjeu du conflit, peuvent aussi bien être alliés qu’être adversaires. Rien que pour la seule région de Kidal, on trouve ainsi des dizaines de tribus/fractions qui peuvent à un moment ou à un autre entrer en concurrence. Et au sein même de ces fractions, des individualités peuvent s’inscrire dans des stratégies de concurrence. L’une d’elles, mais pas n’importe laquelle et pas pour n’importe quelle raison, a choisi d’utiliser l’islamisme radical comme étendard en novembre 2011. Si on ne comprend pas à la fois qui et pourquoi, toute lecture du conflit devient pratiquement impossible.
M. L. : Avant de revenir aux racines du conflit qui pourrit cette partie de la planète, peux-tu nous décrire l’articulation sociale entre Touaregs, Peuhls et Songhaïs et donc nous expliquer pourquoi il ne semble pas y avoir conflit là ?
G. B. : Sans oublier les tribus arabes : Berabichs, Lemhars, Kountas, qui jouent un grand rôle dans la question. Il y a bien sûr des conflits entre Touaregs et Songhaïs ou entre Arabes et Peulhs, mais ces conflits peuvent prendre plusieurs formes selon les moments : ils peuvent parfois opposer par exemple Arabes contre Touaregs, ou d’autres fois prendre une tournure plus sociale en opposant une alliance temporaire de « grandes » tribus arabes et touarègues contre leurs « petites » tribus respectives, elles aussi alliées pour la circonstance. On sort alors du conflit tribal pour entrer dans un conflit politique entre acteurs à statuts sociaux différents. C’est une autre des dimensions qui rendent cette guerre si compliquée à comprendre de France. Une de plus. Prenons le MNLA (Mouvement national pour la libération de l’Azawad) par exemple, un mouvement politique armé très majoritairement touareg. Son vice-président, Djéry Maïga, est Songhaï. Lors de la prise de Gao par le MNLA début 2012, avant que le Mujao djihadiste l’en déloge par les armes, les Songhaïs ont réactivé une milice d’auto-défense créée en 1995, le Ganda Koy (« les maîtres de la terre ») qu’ils ont renommée Ganda Iso (« les fils de la terre »). Eh bien, dans cette milice on trouve également des Touaregs. Difficile, dans ces conditions, de vouloir absolument isoler et énoncer des déterminants qui viendraient expliquer, dans leur grande simplicité, la raison des choses.
M. L. : Les choses sont encore plus compliquées pour les Français parce que, dans leur cas, l’imaginaire joue un rôle important. Pour eux, le Nord-Mali fait partie de ce Sahara mythique où la personne du père de Foucauld joue un rôle important. C’est un désert, où il n’y a personne, traversé par des hommes bleus sur leur chameaux. La complexité de ce que tu décris nous échappe complètement.
G. B. : En fait, ce qui rend les choses en apparence si compliquées, c’est que j’essaie de les exposer dans une « pensée d’ici » qui porte ses propres concepts et systèmes classificatoires. Sur place, c’est beaucoup plus simple, parce tout le monde partage peu ou prou les mêmes référents et évolue dans un contexte communautaire où toutes ces questions, que nous nous pouvons différencier en discontinuités catégorielles (ce qui relève spécifiquement du tribal, du social, du politique, de l’histoire, de la culture), sont vécues comme relevant d’un seul registre où se diluent instantanément toutes les contradictions ou aberrations qu’on pourrait y lire. C’est juste un problème d’altérité : comment l’autre doit-il s’y prendre pour devenir lisible et compréhensible ? Avec, tout au fond, la question de l’universalité : existe-t-il un outil capable d’embrasser universellement tous les questionnements sociétaux, quels que soient les lieux ou les moments. Alors, à la question posée juste avant : comment l’autre doit-il s’y prendre pour devenir lisible ? La réponse est : ça dépend par qui on veut être lu. Si on veut être soutenu politiquement, économiquement, médiatiquement, etc., par l’Occident, alors on endosse le costume « laïque et démocratique », mais si on veut l’être par les richissimes pays du Golfe, alors on devient « djihadiste salafiste ». Ni un discours ni un autre ne démontre que cela fait sens à l’intérieur du problème, mais, cela faisant sens à l’extérieur, ce sont des options stratégiques qui se retrouvent distribuées plus ou moins uniformément au sein des différents groupes locaux (j’exclus les groupes armés extérieurs, Aqmi par exemple) en fonction de leurs rapports de force. D’où le titre Dans les mâchoires du chacal. C’est un ami de Kidal qui a utilisé un jour cette expression pour m’expliquer l’inconfortable position touarègue depuis plus de cinquante ans : être pris en tenaille entre deux mâchoires, celle, arabo-musulmane, venue du Maghreb et du Golfe, et celle venue d’Occident, portée par le gouvernement de Bamako à travers le concept d’État-nation dans lequel toutes les spécificités n’ont plus qu’à se fondre, quitte à réapparaître ensuite sous forme de folklore. C’est un vrai débat.
M. L. : Pour les gens de ma génération, cette affaire commence dans les années 1970, illustrée par la détention de Françoise Claustre et le conflit entre Hissène Habré et Goukouni Oueddei. Tu m’as fait remarquer par ailleurs que cela relevait de l’histoire du Tchad. Cela montre bien à quel point tout ce qui concerne cette partie du monde est sujet à confusion. Pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui, il est donc nécessaire de faire un retour historique, quelques années en arrière.
G. B. : Il y a trois dates-clés importantes. La première, c’est le 12 avril 1904 lorsque les troupes françaises réalisent leur jonction en plein Sahara au puits de Timeiaouine. L’Algérie était alors un département et l’Afrique noire, une colonie, relevant donc de deux administrations différentes. Paris traça donc une ligne de démarcation passant par Timeiaouine, découpant en ligne droite le Sahara – et la société touarègue – en deux. Tant que cette ligne n’était qu’administrative, elle eut peu d’importance ; elle en prit une quand elle devint frontière entre deux États, Mali et Algérie. La seconde date, c’est 1963. Dès 1959, on commençait à évoquer l’éventualité d’une indépendance et la création de ce nouveau pays. À cette évocation, tous les notables du nord, Songhaïs, Touaregs, Peulhs, Arabes, chefs traditionnels ou religieux, chefs de tribus, se réunirent à Gao. Ils écrivirent une lettre à De Gaulle lui demandant de leur rendre leur pays tel que la France l’avait trouvé en arrivant et que jamais ils n’accepteront d’appartenir à quelque entité politique que ce soit avec les « sudistes ». D’autant plus que la France projetait de confier tout le pouvoir à ces derniers. Malgré cela, le Mali est créé fin 1961 (après quelques détours par une Fédération sénégalo-soudanaise sans lendemain) et, aussitôt, l’armée nationale, composée exclusivement de gens du sud, envahit le nord… « Envahit » parce que, d’une part, ça a été vécu comme une invasion par les nordistes, et, de l’autre, parce qu’aucun sudiste n’avait jamais mis les pieds dans ce désert dont il ignorait jusqu’au nom. C’était donc littéralement une armée d’occupation, une seconde colonisation. Début 1963, une rébellion armée éclate dans la région de Kidal. La riposte « malienne » est hors de proportion : Bamako envoie des soldats par milliers, des blindés, des automitrailleuses, pour combattre une poignée de Touaregs à dos de chameaux. Ça a été un massacre : hommes et campements hachés à la mitrailleuse, femmes violées, puits empoisonnés, etc. Un véritable bain de sang. Les chefs rebelles tentèrent de trouver du soutien du côté de l’Algérie. Ben Bella les livra à Modibo Keita au nom de l’idéal socialiste (Keita était membre de la SFIO et de l’Internationale socialiste). Pour eux, ce n’était qu’une révolte de nomades féodaux, archaïques et nostalgiques de l’époque coloniale. Toute la région de Kidal est alors fermée et placée sous gouvernorat militaire. Pour ces enfants qui virent leurs parents torturés et assassinés sous leurs yeux, « Mali » était devenu synonyme de haine inextinguible. Kadhafi leur ouvrira ses camps d’entraînement où, du Tchad au Liban, ils apprendront la guerre moderne. Enfin, dernière date-clé, mai 1990 : le déclenchement de la seconde rébellion. En moins de deux mois, l’armée malienne est défaite et chassée du nord par la rébellion. Le même scénario se reproduira à l’identique en mai 2006 et en mars 2012.
M. L. : Ce que tu viens de nous décrire montre à l’évidence que le problème du Nord-Mali déborde des limites de ce pays proprement dit. L’essentiel des affrontements se passe dans ce que l’on peut appeler la bande sahélo-saharienne qui couvre à peu près 5 millions de km2 et qui coupe cette partie de l’Afrique en deux. Autre question, le sous-sol de ces régions recèle-t-il des réserves de ce que l’on pourrait appeler des terres rares et autres minerais précieux ?
G.B. : Là, on touche un point sensible : l’Algérie. Le sous-sol regorge de pétrole, d’or, d’uranium. Le gouvernement malien a cédé des concessions à des compagnies internationales qui ont commencé à explorer la zone il y a une dizaine d’années. L’endroit le plus prometteur est Taoudenni, à l’ouest de Kidal. Mais la géologie s’en mêle : les nappes pétrolifères semblent ininterrompues entre Hassi-Messaoud et Taoudenni. Or le synclinal du sous-sol penche vers le Mali, ce qui fait qu’y extraire massivement l’or noir pourrait, m’a-t-on dit (je ne suis pas géologue), « vider » partiellement le sous-sol algérien. Son économie dépendant à 90 % du pétrole et du gaz, « on » dit donc que l’Algérie serait prête à tout pour empêcher cette exploitation. Alors, hasard ou manœuvre retorse, je ne sais pas, mais lorsqu’en 2001 le GSPC (qui deviendra Aqmi plus tard) enlève 21 touristes européens à Illizi en Algérie, il s’empresse de filer vers Taoudenni. Second hasard, Al-Para, le leader du GSPC, était à la fois un ancien des services secrets algériens (DRS) et le neveu d’un des généraux algériens les plus influents. L’irruption des djihadistes au Nord-Mali aurait été organisée par la DRS à la fois pour débarrasser l’Algérie du GSPC et rendre le Nord-Mali instable et dangereux, empêchant durablement toute exploitation du sous-sol.
M. L. : En fait, tu affirmes que le djihadisme dans cette partie de l’Afrique est un mirage qui sert les intérêts d’autres gens que les intéressés. L’Algérie d’une part, afin de préserver son pré carré, l’Arabie saoudite et ses amis afin d’avoir leur soutien financier, ce qui leur permet en prime de mettre un pied dans cette région. La question que je te pose maintenant : les groupes insurgés touaregs n’ont-ils pas vu les risques encourus ?
G.B. : En juillet 2006, l’ADC (Alliance démocratique pour le changement), à l’origine de la troisième rébellion, après avoir chassé l’armée malienne du nord, s’est attaquée directement à Aqmi, tuant deux chefs militaires et de nombreux djihadistes. Ils ont rencontré en septembre à Paris des sénateurs, des ministres et les services français pour obtenir une aide financière et logistique. Leur objectif était d’éradiquer Aqmi qui, selon eux, entravait le développement de la région, comme expliqué plus haut. Fin de non-recevoir. Aqmi s’est vengé en octobre en attaquant une base rebelle dans l’Adrar, après quoi ils signèrent un pacte de non-agression. Sans surprise, les leaders de l’ADC de 2006 sont ceux qui fondèrent en 2011 Ansar ed-Dine, le seul mouvement djihadiste 100 % local, obtenant du Qatar ce qu’ils n’avaient pu obtenir de Paris…
M. L. : Pour masquer l’incompétence des services français, il va falloir prétendre défendre la civilisation !
G. B. : En effet, toute guerre a besoin d’une « histoire racontée ». On se rappelle Bush et ses armes de destruction massive inventées de toutes pièces, ou Sarkozy vendant aux Français une population civile de Benghazi massacrée par Kadhafi… Kadhafi a de tout temps massacré les islamistes radicaux de Benghazi (ce sont ces mêmes islamistes senoussistes qui ont tué Charles de Foucauld), il a même pour cela été déclaré « pire ennemi de l’islam » par Ben Laden lui-même. Le story-telling de Hollande pour « nous » vendre sa guerre a été les « 6 000 otages de Bamako », ces 6 000 Français qui allaient tomber aux mains des djihadistes lorsque ceux-ci prirent la route de Bamako le 10 janvier 2013, « nous » obligeant à intervenir en toute urgence. Sauf que… sauf que cela n’a jamais existé. Ce que ces djihadistes ont voulu faire, sachant qu’une opération militaire internationale se préparait, c’était de prendre l’aéroport de Sévaré. Sans Sévaré, pas d’intervention militaire possible. Mais on n’emmène pas une opinion publique faire la guerre pour un aéroport… Alors, on invente une histoire. S’ils avaient voulu prendre Bamako, c’était au printemps 2012 : l’armée était laminée, le gouvernement renversé et toutes les institutions à la dérive. Pourquoi attendre une résolution de l’ONU, une armée remise sur pied, l’Assemblée nationale reconstituée et un nouveau président fraîchement élu ?
M. L. : Eh oui, Hollande face aux problèmes intérieurs français avait besoin d’une bonne guerre, franche, joyeuse et rapide. Elle n’est rien de tout cela et elle dure et durera. Ce qui fait dire à Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l’Afrique que « la France est piégée au Mali pour de nombreux mois, sinon de nombreuses années ». Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie de nous avoir fourni toutes ces informations qui nous permettent d’avoir une idée de l’arrière-plan de ce conflit qui va encore continuer probablement longtemps, hélas. Je crois que nous avons bien compris que l’étiquette « djihadiste » montée en épouvantail par les médias est dans cette situation complètement opportuniste. Je ne peux qu’inviter le lecteur intéressé par ce qui se passe au Nord-Mali à se procurer ton excellent petit livre pour compléter ce que tu viens de nous évoquer. Merci Gael !
Propos recueillis par Pierre Sommermeyer pour Le Monde libertaire