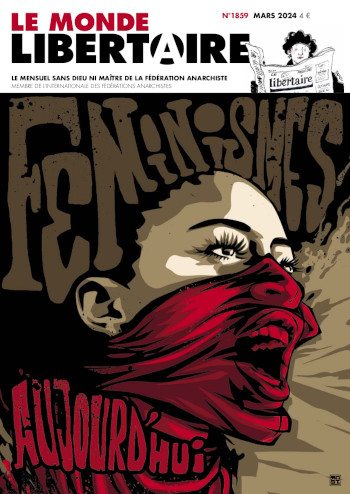Les articles du ML papier > Culture populaire et culture militaire, Ces chanteurs, dessinateurs, ou écrivains qui disent non
Les articles du ML papier

par Cédric • le 7 janvier 2019
Culture populaire et culture militaire, Ces chanteurs, dessinateurs, ou écrivains qui disent non
Lien permanent : https://monde-libertaire.net/index.php?articlen=3816
avec une pensée pour Pétillon
article extrait du Monde libertaire n°1800 de novembre 2018
Le discours officiel sur la guerre de 14-18 qu’il soit belliciste ou pacifiste, qu’il s’inscrive dans la construction des identités nationales ou dans l’édification d’une Europe libérale, est rarement dénué d’arrières-pensées politiques. Les discours alternatifs non plus, d’ailleurs, mais eux ne se drapent pas dans un récit pseudo-objectif. Ils assument leur subjectivité – et ça fait toute la différence. Alors, arbitraire pour arbitraire, pour commémorer à notre façon le siècle de paix, de justice sociale et de fraternité internationale qui est le nôtre depuis la fin de la der des ders (il faut sauver l’uchronie !), voici trois exemples tirés presque au hasard, de la culture populaire : Brassens, Tardi, Pécherot. Trois points de vue sur la Grande Guerre, situés du mauvais côté de la mire : celui des fusillés pour l’exemple.
Allons enfants de l’apatrie,
Brassens contre Rouget de Lisle
Les Patriotes
Georges Brassens
Les invalid’s chez nous, l’revers de leur médaille
C’est pas d’être hors d’état de suivr’ les fill’s, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir retourner au champ de bataille.
Le rameau d’olivier n’est pas notre symbole, non !
Ce que, par-dessus tout, nos aveugles déplorent,
C’est pas d’être hors d’état d’se rincer l’œil, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore.
La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon.
Et les sourds de chez nous, s’ils sont mélancoliques,
C’est pas d’être hors d’état d’ouïr les sirènes, cré de nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir entendre au défilé d’la clique,
Les échos du tambour, de la trompette et du clairon.
Et les muets d’chez nous, c’qui les met mal à l’aise
C’est pas d’être hors d’état d’conter fleurette, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir reprendre en chœur La Marseillaise.
Les chansons martiales sont les seules que nous entonnons.
Ce qui de nos manchots aigrit le caractère,
C’est pas d’être hors d’état d’pincer les fess’s, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir faire le salut militaire.
Jamais un bras d’honneur ne sera notre geste, non !
Les estropiés d’chez nous, ce qui les rend patraques,
C’est pas d’être hors d’état d’courir la gueus’, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir participer à une attaque.
On rêve de Rosalie, la baïonnette, pas de Ninon.
[…] Quant à nos trépassés, s’ils ont tous l’âme en peine,
C’est pas d’être hors d’état d’mourir d’amour, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir se faire occire à la prochaine.
Au monument aux morts, chacun rêve d’avoir son nom.
Dans cette chanson de 1976 passent encore les gueules cassées de la Grande Guerre. Face au défilé de la clique, Brassens riposte par une structure rigoureuse : il fait marcher au pas une collection de soldats de plomb – et de bois : aveugles, sourds, muets, manchots, estropiés… Entre le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe, il présente, naturellement associées à chacun des sens, deux conceptions antinomiques, l’amour et la mort, exprimées à l’infinitif : suivre les filles, se rincer l’œil, pincer les fesses (mais quand donc commence le harcèlement ?!), mourir d’amour… qui s’opposent à retourner au champ de bataille, lorgner le drapeau tricolore, faire le salut militaire, se faire occire à la prochaine…
Brassens ne s’en prend pas à une idéologie (militarisme, nationalisme...) mais à ceux qui la portent, seulement désignés par leur handicap. Il tire sur l’ambulance, et tourne en dérision les invalides de guerre que l’État avait érigés en héros. Pourquoi s’en prendre aux victimes plutôt qu’aux criminels ? Ce qu’il leur reproche, ce n’est pas leur handicap physique mais leur patriotisme, perçu comme une infirmité intellectuelle. C’est leur manque de défenses immunitaires contre l’idéologie dominante alors même qu’elles en sont le cœur de cible. Étrange syndrome de Stockholm où les martyrs se font les complices de leurs bourreaux. À la cruauté de la situation, Brassens réplique par sa férocité poétique : il lutte, politiquement, contre l’idéologie militariste, en s’en prenant, esthétiquement, à la musique militaire – dont on sait ce qu’elle est à la musique : loin des « échos du tambour, de la trompette et du clairon », il est « celui qui passe à côté des fanfares Et qui chante en sourdine un petit air frondeur » (Le Pluriel). Rythmiquement pour évoquer la marche martiale, il choisit l’alexandrin, dont la solennité se boursouffle en monstrueux vers de 14 syllabes – tératologie du tétradécasyllabe. Son esthétique personnelle est tout autre : aux rythmes binaires de l’alexandrin, il préfère l’impair, comme Verlaine, sans rien sur lui qui pèse ou qui pose, pentasyllabe (Les Ricochets), heptasyllabe (Les Lilas), ennéasyllabe (Au Bois de mon coeur) … C’est en musicien qu’il combat le bellicisme : il change nos représentations grâce à ses chansonnettes qui nous touchent plus sûrement que les discours officiels. Ici, il prend à contre-pied deux chansons du patrimoine national : La Marseillaise, tout d’abord, dont les paroles, si elle était un jeu vidéo, seraient interdites aux moins de 18 ans tant elles contiennent des scènes de violence explicite. Mais, implicitement – « On rêve de Rosalie, la baïonnette, pas de Ninon » – Brassens vise aussi le chansonnier Théodore Botrel qui, en 14-18, a soutenu le moral des troupes avec La Rosalie (la baïonnette) : « Rosalie est élégante Sa robe-fourreau collante – Verse à boire ! – La revêt jusqu’au quillon Buvons donc ! Mais elle est irrésistible Quand elle surgit, terrible, – Verse à boire ! – Toute nue » Eros, Thanatos Dionysos. Les femmes, la guerre, l’alcool, dans un même cocktail phallocrate. Il n’y a pas, comme chez Brassens, opposition, mais collusion entre l’amour et la mort.
Face à ce culte mortifère du militarisme, face à cette culture officielle, Brassens oppose son amour de la vie, son pacifisme sans concession ; et on a bien besoin d’entendre, parfois, une voix singulière et libre, qui chante La Mauvaise herbe : « Quand l’jour de gloire est arrivé, Comm’ tous les autr’s étaient crevés, Moi seul connus le déshonneur De n’pas êtr’ mort au champ d’honneur. Je suis d’la mauvaise herbe, Braves gens, braves gens, C’est pas moi qu’on rumine Et c’est pas moi qu’on met en gerbe… »
Putain de BD !
Tardi monte au front
La grande affaire de Tardi, c’est la guerre de 14 ; c’est un leitmotive esthétique, une obsession idéologique. Il revient à la charge, dans son œuvre graphique, de façon récurrente. Son diptyque, Putain de guerre, s’attache à déconstruire les discours officiels : les discours religieux et scolaires, ainsi, se rejoignent comiquement : « Les “rôtisseurs de la Pucelleˮ, selon le curé [les Anglais], voulaient bouffer du Hun. […] Nos “ennemis héréditaires” [les Anglais], selon l’instituteur, voulaient enfoncer les lignes de notre ennemi commun [les Allemands]. Moi, je vous le dis, dans toute cette affaire, je n’avais pas d’ennemi et je trouvais ça un peu fort qu’on m’ait envoyé là où j’étais. » Mais l’instituteur et le curé ne font ici que relayer le discours de leurs autorités de tutelle : « La mobilisation n’est pas la guerre. Dans les circonstances présentes, elle apparaît, au contraire, comme le meilleur moyen d’assurer la paix dans l’honneur », affirme le Président Poincaré ; l’évêque Baudrillart surenchérit : « Je pense que ces événements sont fort heureux, il y a quarante ans que je les attends. La France se refait, et selon moi, elle ne pouvait pas se refaire autrement que par la guerre qui la purifie. » Dix ans après la douloureuse séparation de l’Église et de l’État, les bonnes volontés se rejoignent, dans l’amour spirituel du Christ comme dans l’amour laïque de la paix ! Certains hommes de lettres célèbrent également l’esthétique de la guerre. Comme Charles Péguy, Paul Bourget s’enthousiasme : « C’est encore une des surprises de cette guerre et l’une de ses merveilles, le rôle éclatant qu’y joue la poésie. »
Graphiquement, Tardi combat ces discours officiels de différentes façons : il place son carnet à dessins à hauteur d’homme – et son narrateur anonyme, est bien conscient de sa propre insignifiance : « Après tout, un pauvre, ça crève dans l’indifférence totale. » Il s’exprime à travers un nous ou un on théorique, équivalent linguistique du soldat inconnu. Moins qu’un actant, il est un regard, un relais du lecteur, qui lui permet de voir ce qui relève, bien souvent, de l’innommable. Tardi invente un langage graphique pour exprimer ce qui semble inaccessible à la parole. Ces corps morcelés, écorchés dont on ne sait si le compte-rendu graphique procède de la planche d’anatomie ou de la vue en éclaté, forment autant de puzzles insolubles. Le travail de la couleur est très particulier ; le rouge garance des pantalons ou du sang, le bleu des vestes, ressortent sur des teintes généralement plus pastel. Sur fond de neige, cela forme un drapeau tricolore peu ragoutant.
Tardi démontre que le bellicisme n’est qu’un des aspects d’autres pathologies croisées, le racisme et ses avatars américains ou européens, (esclavagisme ou colonialisme, avec ces Noirs sous-équipés dont il ne faudrait pas faire des héros), ou le capitalisme des magnats de l’industrie, Schneider, St Chamond, Fiat, Krupp, Vickers, Renault... Le capitalisme aussi, c’est la guerre. Les décisions de l’intelligence militaire – dont on sait ce qu’elle est à l’intelligence – et les progrès technologiques sont ridiculisés, souvent par des ellipses narratives (l’aéroplane, le zeppelin) ; ils succèdent aux anachronismes hallucinants – cette joute équestre digne du Moyen Âge entre hulans et dragons. Tardi pointe ainsi non pas une guerre d’un autre temps, mais une guerre qui devrait n’être d’aucun temps. Au niveau de la structure, chaque page est généralement divisée en trois vignettes, permettant certaines variations originales (portrait en médaillon, ligne de tir d’une mitrailleuse, verticalité de la montagne). Parfois, certaines de ces doubles pages se répondent, soulignant graphiquement la symétrie des situations dans les deux camps ; quoi qu’en disent les chefs d’État, les religieux, les hommes de Lettres, même, il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Les situations sont interchangeables, la démonstration est graphique. Car il s’agit de lutter par l’image, contre l’iconographie officielle, contre ces cartes postales édifiantes, documents de propagande, présentées en fin d’ouvrage par J.-P. Verney. Dans un entretien avec Luc Révillon, Tardi s’en prend violemment aux travaux de l’Historial de Péronne qui estime que certains combattants consentaient à la guerre : « Je trouve […] scandaleuse cette idée d’un sacrifice librement consenti. […] Il y a l’Historial de Péronne et ses historiens, mais il y a aussi l’école de Craonne dont je me sens beaucoup plus proche. Les mutineries, dont Craonne est le lieu symbolique, ne sont pas récupérables sous prétexte que ces refus d’obéissance ne vont pas dans le sens de ce qu’il est bon d’enseigner ou de vendre aux jeunes générations ». Avec Tardi, la bande dessinée s’inscrit dans un contre-discours.
Il faut sauver le soldat Jonas,
Patrick Pécherot
Dans son roman noir Tranchecaille, Patrick Pécherot met en scène le capitaine Duparc, chargé de la défense du 2° classe Jonas accusé d’avoir assassiné son supérieur. Jonas, idiot ou réfractaire ? C’est à la Justice militaire – dont on sait ce qu’elle est à la justice – de trancher. Mais l’enquête n’est pas simplement factuelle. Elle est, surtout, culturelle, tant elle fait référence à des chansons, à des auteurs, à des journaux différents ; et on comprend rapidement que, ce qui sera jugé là, ce n’est pas tant les faits eux-mêmes que le risque d’une insubordination : il faut faire un exemple.
Les références culturelles sont fournies, et avant de s’achever sur La Chanson de Craonne, le roman aura évoqué nombre d’hymnes du parti de l’ordre (Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, « La Madelon ; Sambre et Meuse. Un fameux concert, tout en cuivres et en grosse caisse », et surtout La Marseillaise ; mais certains entonnent aussi des chants moins patriotiques, comme La Semaine sanglante, et une partie de l’enquête consiste à les identifier : « – Vous avez chanté L’Internationale, oui ou non ? – J’aurais aussi bien chanté autre chose. Les légionnaires, ils chantent le boudin, ça en fait-y des charcutiers ? »
Rimbaud, Sully Prudhomme, Pindare, Nietzsche, nombreux sont les écrivains et intellectuels à être convoqués à la barre. Certains d’entre eux constituent de véritables indices idéologiques, Barbusse, Dorgelès, Genevoix, Zola, d’un côté, Léon Daudet, Auguste Le Bon de l’autre ; mais les pistes sont brouillées, car certains changent leur fusil d’épaule : « M. Gustave Hervé, qui dirige La Victoire, journal de haute tenue, a commis jadis des pamphlets anarchistes dans un brûlot, La Guerre sociale. » Nombreux sont les titres de presse à être ainsi évoqués, Le Petit journal, L’Action française, Le Clairon du poilu ou Le Petit Parisien : « L’ouragan d’acier passe sur nos têtes sans nous émouvoir. C’est féérique » ; mais là encore, l’identification idéologique des titres évoqués n’est pas toujours facile : « Le Bonnet rouge, il est passé par toutes les couleurs. Celles de l’union sacrée comme les autres. Un coup contre la guerre, un coup pour l’armée. […] Vous connaissez son patron, Almeyreda. Il se veut anarchiste, c’est un arlequin. Pour composer ses articles, les encres Lorilleux n’auront bientôt plus assez de teintes à leur palette. »
Patrick Pécherot le démontre : face au bourrage de crâne de la propagande officielle, la culture populaire peut parfois être le lieu d’une résistance à la domination culturelle. Il évoque la généalogie dans laquelle il s’inscrit, qui passe par Sherlock Holmes, Rouletabille, Gaston Leroux, Léo Malet ou encore Gustave Le Rouge – l’auteur du Voleur de visages, précise-t-il, pas celui de la collection « Patrie », qui produit, pendant la guerre, des récits de propagande – car il ne suffit pas qu’une culture soit populaire pour qu’elle soit progressiste. Si bien qu’entre ces différents discours, officiels ou subversifs, c’est au lecteur de faire sa propre investigation, son propre parcours. L’auteur reprendra le même principe avec Hével, son dernier roman. D’ailleurs, une allusion discrète unit peut-être ces deux récits : « Vanité, tout est vanité », peut-on lire dans Tranchecaille. C’est ainsi que le mot hébreu hével est traduit, dans L’Ecclésiaste.
Conclusion :
Chanson, bande dessinée, roman noir… les formes de la culture populaire offrent parfois de la Grande Guerre, dans leur langage propre, une image alternative à celle du discours officiel. Mais prudence : la capacité du système à assimiler les propos les plus contestataires est grande. On a demandé à Brassens d’entrer à l’Académie française ; Tardi s’est vu proposer la Légion d’honneur. Tous deux ont refusé. Bientôt nos institutions réaliseront que Patrick Pécherot est digne de figurer à leur tableau de chasse. Il est bien sûr seul maître de la réponse qu’il apportera. Mais, sans doute, au moment suprême, quelques notes de Brassens lui trotteront-elles en tête : « Comme de la patrie je ne mérite guère J’ai pas la Croix d’honneur, j’ai pas la croix de guerre Et je n’en souffre pas avec trop de rigueur J’ai ma rosette à moi : c’est un accroche-cœur » (La Tondue)

Allons enfants de l’apatrie,
Brassens contre Rouget de Lisle
Les Patriotes
Georges Brassens
Les invalid’s chez nous, l’revers de leur médaille
C’est pas d’être hors d’état de suivr’ les fill’s, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir retourner au champ de bataille.
Le rameau d’olivier n’est pas notre symbole, non !
Ce que, par-dessus tout, nos aveugles déplorent,
C’est pas d’être hors d’état d’se rincer l’œil, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore.
La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon.
Et les sourds de chez nous, s’ils sont mélancoliques,
C’est pas d’être hors d’état d’ouïr les sirènes, cré de nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir entendre au défilé d’la clique,
Les échos du tambour, de la trompette et du clairon.
Et les muets d’chez nous, c’qui les met mal à l’aise
C’est pas d’être hors d’état d’conter fleurette, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir reprendre en chœur La Marseillaise.
Les chansons martiales sont les seules que nous entonnons.
Ce qui de nos manchots aigrit le caractère,
C’est pas d’être hors d’état d’pincer les fess’s, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir faire le salut militaire.
Jamais un bras d’honneur ne sera notre geste, non !
Les estropiés d’chez nous, ce qui les rend patraques,
C’est pas d’être hors d’état d’courir la gueus’, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir participer à une attaque.
On rêve de Rosalie, la baïonnette, pas de Ninon.
[…] Quant à nos trépassés, s’ils ont tous l’âme en peine,
C’est pas d’être hors d’état d’mourir d’amour, cré nom de nom,
Mais de ne plus pouvoir se faire occire à la prochaine.
Au monument aux morts, chacun rêve d’avoir son nom.
Dans cette chanson de 1976 passent encore les gueules cassées de la Grande Guerre. Face au défilé de la clique, Brassens riposte par une structure rigoureuse : il fait marcher au pas une collection de soldats de plomb – et de bois : aveugles, sourds, muets, manchots, estropiés… Entre le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe, il présente, naturellement associées à chacun des sens, deux conceptions antinomiques, l’amour et la mort, exprimées à l’infinitif : suivre les filles, se rincer l’œil, pincer les fesses (mais quand donc commence le harcèlement ?!), mourir d’amour… qui s’opposent à retourner au champ de bataille, lorgner le drapeau tricolore, faire le salut militaire, se faire occire à la prochaine…
Brassens ne s’en prend pas à une idéologie (militarisme, nationalisme...) mais à ceux qui la portent, seulement désignés par leur handicap. Il tire sur l’ambulance, et tourne en dérision les invalides de guerre que l’État avait érigés en héros. Pourquoi s’en prendre aux victimes plutôt qu’aux criminels ? Ce qu’il leur reproche, ce n’est pas leur handicap physique mais leur patriotisme, perçu comme une infirmité intellectuelle. C’est leur manque de défenses immunitaires contre l’idéologie dominante alors même qu’elles en sont le cœur de cible. Étrange syndrome de Stockholm où les martyrs se font les complices de leurs bourreaux. À la cruauté de la situation, Brassens réplique par sa férocité poétique : il lutte, politiquement, contre l’idéologie militariste, en s’en prenant, esthétiquement, à la musique militaire – dont on sait ce qu’elle est à la musique : loin des « échos du tambour, de la trompette et du clairon », il est « celui qui passe à côté des fanfares Et qui chante en sourdine un petit air frondeur » (Le Pluriel). Rythmiquement pour évoquer la marche martiale, il choisit l’alexandrin, dont la solennité se boursouffle en monstrueux vers de 14 syllabes – tératologie du tétradécasyllabe. Son esthétique personnelle est tout autre : aux rythmes binaires de l’alexandrin, il préfère l’impair, comme Verlaine, sans rien sur lui qui pèse ou qui pose, pentasyllabe (Les Ricochets), heptasyllabe (Les Lilas), ennéasyllabe (Au Bois de mon coeur) … C’est en musicien qu’il combat le bellicisme : il change nos représentations grâce à ses chansonnettes qui nous touchent plus sûrement que les discours officiels. Ici, il prend à contre-pied deux chansons du patrimoine national : La Marseillaise, tout d’abord, dont les paroles, si elle était un jeu vidéo, seraient interdites aux moins de 18 ans tant elles contiennent des scènes de violence explicite. Mais, implicitement – « On rêve de Rosalie, la baïonnette, pas de Ninon » – Brassens vise aussi le chansonnier Théodore Botrel qui, en 14-18, a soutenu le moral des troupes avec La Rosalie (la baïonnette) : « Rosalie est élégante Sa robe-fourreau collante – Verse à boire ! – La revêt jusqu’au quillon Buvons donc ! Mais elle est irrésistible Quand elle surgit, terrible, – Verse à boire ! – Toute nue » Eros, Thanatos Dionysos. Les femmes, la guerre, l’alcool, dans un même cocktail phallocrate. Il n’y a pas, comme chez Brassens, opposition, mais collusion entre l’amour et la mort.
Face à ce culte mortifère du militarisme, face à cette culture officielle, Brassens oppose son amour de la vie, son pacifisme sans concession ; et on a bien besoin d’entendre, parfois, une voix singulière et libre, qui chante La Mauvaise herbe : « Quand l’jour de gloire est arrivé, Comm’ tous les autr’s étaient crevés, Moi seul connus le déshonneur De n’pas êtr’ mort au champ d’honneur. Je suis d’la mauvaise herbe, Braves gens, braves gens, C’est pas moi qu’on rumine Et c’est pas moi qu’on met en gerbe… »
Putain de BD !
Tardi monte au front
La grande affaire de Tardi, c’est la guerre de 14 ; c’est un leitmotive esthétique, une obsession idéologique. Il revient à la charge, dans son œuvre graphique, de façon récurrente. Son diptyque, Putain de guerre, s’attache à déconstruire les discours officiels : les discours religieux et scolaires, ainsi, se rejoignent comiquement : « Les “rôtisseurs de la Pucelleˮ, selon le curé [les Anglais], voulaient bouffer du Hun. […] Nos “ennemis héréditaires” [les Anglais], selon l’instituteur, voulaient enfoncer les lignes de notre ennemi commun [les Allemands]. Moi, je vous le dis, dans toute cette affaire, je n’avais pas d’ennemi et je trouvais ça un peu fort qu’on m’ait envoyé là où j’étais. » Mais l’instituteur et le curé ne font ici que relayer le discours de leurs autorités de tutelle : « La mobilisation n’est pas la guerre. Dans les circonstances présentes, elle apparaît, au contraire, comme le meilleur moyen d’assurer la paix dans l’honneur », affirme le Président Poincaré ; l’évêque Baudrillart surenchérit : « Je pense que ces événements sont fort heureux, il y a quarante ans que je les attends. La France se refait, et selon moi, elle ne pouvait pas se refaire autrement que par la guerre qui la purifie. » Dix ans après la douloureuse séparation de l’Église et de l’État, les bonnes volontés se rejoignent, dans l’amour spirituel du Christ comme dans l’amour laïque de la paix ! Certains hommes de lettres célèbrent également l’esthétique de la guerre. Comme Charles Péguy, Paul Bourget s’enthousiasme : « C’est encore une des surprises de cette guerre et l’une de ses merveilles, le rôle éclatant qu’y joue la poésie. »
Graphiquement, Tardi combat ces discours officiels de différentes façons : il place son carnet à dessins à hauteur d’homme – et son narrateur anonyme, est bien conscient de sa propre insignifiance : « Après tout, un pauvre, ça crève dans l’indifférence totale. » Il s’exprime à travers un nous ou un on théorique, équivalent linguistique du soldat inconnu. Moins qu’un actant, il est un regard, un relais du lecteur, qui lui permet de voir ce qui relève, bien souvent, de l’innommable. Tardi invente un langage graphique pour exprimer ce qui semble inaccessible à la parole. Ces corps morcelés, écorchés dont on ne sait si le compte-rendu graphique procède de la planche d’anatomie ou de la vue en éclaté, forment autant de puzzles insolubles. Le travail de la couleur est très particulier ; le rouge garance des pantalons ou du sang, le bleu des vestes, ressortent sur des teintes généralement plus pastel. Sur fond de neige, cela forme un drapeau tricolore peu ragoutant.
Tardi démontre que le bellicisme n’est qu’un des aspects d’autres pathologies croisées, le racisme et ses avatars américains ou européens, (esclavagisme ou colonialisme, avec ces Noirs sous-équipés dont il ne faudrait pas faire des héros), ou le capitalisme des magnats de l’industrie, Schneider, St Chamond, Fiat, Krupp, Vickers, Renault... Le capitalisme aussi, c’est la guerre. Les décisions de l’intelligence militaire – dont on sait ce qu’elle est à l’intelligence – et les progrès technologiques sont ridiculisés, souvent par des ellipses narratives (l’aéroplane, le zeppelin) ; ils succèdent aux anachronismes hallucinants – cette joute équestre digne du Moyen Âge entre hulans et dragons. Tardi pointe ainsi non pas une guerre d’un autre temps, mais une guerre qui devrait n’être d’aucun temps. Au niveau de la structure, chaque page est généralement divisée en trois vignettes, permettant certaines variations originales (portrait en médaillon, ligne de tir d’une mitrailleuse, verticalité de la montagne). Parfois, certaines de ces doubles pages se répondent, soulignant graphiquement la symétrie des situations dans les deux camps ; quoi qu’en disent les chefs d’État, les religieux, les hommes de Lettres, même, il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants de l’autre. Les situations sont interchangeables, la démonstration est graphique. Car il s’agit de lutter par l’image, contre l’iconographie officielle, contre ces cartes postales édifiantes, documents de propagande, présentées en fin d’ouvrage par J.-P. Verney. Dans un entretien avec Luc Révillon, Tardi s’en prend violemment aux travaux de l’Historial de Péronne qui estime que certains combattants consentaient à la guerre : « Je trouve […] scandaleuse cette idée d’un sacrifice librement consenti. […] Il y a l’Historial de Péronne et ses historiens, mais il y a aussi l’école de Craonne dont je me sens beaucoup plus proche. Les mutineries, dont Craonne est le lieu symbolique, ne sont pas récupérables sous prétexte que ces refus d’obéissance ne vont pas dans le sens de ce qu’il est bon d’enseigner ou de vendre aux jeunes générations ». Avec Tardi, la bande dessinée s’inscrit dans un contre-discours.
Il faut sauver le soldat Jonas,
Patrick Pécherot
Dans son roman noir Tranchecaille, Patrick Pécherot met en scène le capitaine Duparc, chargé de la défense du 2° classe Jonas accusé d’avoir assassiné son supérieur. Jonas, idiot ou réfractaire ? C’est à la Justice militaire – dont on sait ce qu’elle est à la justice – de trancher. Mais l’enquête n’est pas simplement factuelle. Elle est, surtout, culturelle, tant elle fait référence à des chansons, à des auteurs, à des journaux différents ; et on comprend rapidement que, ce qui sera jugé là, ce n’est pas tant les faits eux-mêmes que le risque d’une insubordination : il faut faire un exemple.
Les références culturelles sont fournies, et avant de s’achever sur La Chanson de Craonne, le roman aura évoqué nombre d’hymnes du parti de l’ordre (Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, « La Madelon ; Sambre et Meuse. Un fameux concert, tout en cuivres et en grosse caisse », et surtout La Marseillaise ; mais certains entonnent aussi des chants moins patriotiques, comme La Semaine sanglante, et une partie de l’enquête consiste à les identifier : « – Vous avez chanté L’Internationale, oui ou non ? – J’aurais aussi bien chanté autre chose. Les légionnaires, ils chantent le boudin, ça en fait-y des charcutiers ? »
Rimbaud, Sully Prudhomme, Pindare, Nietzsche, nombreux sont les écrivains et intellectuels à être convoqués à la barre. Certains d’entre eux constituent de véritables indices idéologiques, Barbusse, Dorgelès, Genevoix, Zola, d’un côté, Léon Daudet, Auguste Le Bon de l’autre ; mais les pistes sont brouillées, car certains changent leur fusil d’épaule : « M. Gustave Hervé, qui dirige La Victoire, journal de haute tenue, a commis jadis des pamphlets anarchistes dans un brûlot, La Guerre sociale. » Nombreux sont les titres de presse à être ainsi évoqués, Le Petit journal, L’Action française, Le Clairon du poilu ou Le Petit Parisien : « L’ouragan d’acier passe sur nos têtes sans nous émouvoir. C’est féérique » ; mais là encore, l’identification idéologique des titres évoqués n’est pas toujours facile : « Le Bonnet rouge, il est passé par toutes les couleurs. Celles de l’union sacrée comme les autres. Un coup contre la guerre, un coup pour l’armée. […] Vous connaissez son patron, Almeyreda. Il se veut anarchiste, c’est un arlequin. Pour composer ses articles, les encres Lorilleux n’auront bientôt plus assez de teintes à leur palette. »
Patrick Pécherot le démontre : face au bourrage de crâne de la propagande officielle, la culture populaire peut parfois être le lieu d’une résistance à la domination culturelle. Il évoque la généalogie dans laquelle il s’inscrit, qui passe par Sherlock Holmes, Rouletabille, Gaston Leroux, Léo Malet ou encore Gustave Le Rouge – l’auteur du Voleur de visages, précise-t-il, pas celui de la collection « Patrie », qui produit, pendant la guerre, des récits de propagande – car il ne suffit pas qu’une culture soit populaire pour qu’elle soit progressiste. Si bien qu’entre ces différents discours, officiels ou subversifs, c’est au lecteur de faire sa propre investigation, son propre parcours. L’auteur reprendra le même principe avec Hével, son dernier roman. D’ailleurs, une allusion discrète unit peut-être ces deux récits : « Vanité, tout est vanité », peut-on lire dans Tranchecaille. C’est ainsi que le mot hébreu hével est traduit, dans L’Ecclésiaste.
Conclusion :
Chanson, bande dessinée, roman noir… les formes de la culture populaire offrent parfois de la Grande Guerre, dans leur langage propre, une image alternative à celle du discours officiel. Mais prudence : la capacité du système à assimiler les propos les plus contestataires est grande. On a demandé à Brassens d’entrer à l’Académie française ; Tardi s’est vu proposer la Légion d’honneur. Tous deux ont refusé. Bientôt nos institutions réaliseront que Patrick Pécherot est digne de figurer à leur tableau de chasse. Il est bien sûr seul maître de la réponse qu’il apportera. Mais, sans doute, au moment suprême, quelques notes de Brassens lui trotteront-elles en tête : « Comme de la patrie je ne mérite guère J’ai pas la Croix d’honneur, j’ai pas la croix de guerre Et je n’en souffre pas avec trop de rigueur J’ai ma rosette à moi : c’est un accroche-cœur » (La Tondue)
PAR : Cédric
SES ARTICLES RÉCENTS :
Réagir à cet article
Écrire un commentaire ...
Poster le commentaire
Annuler