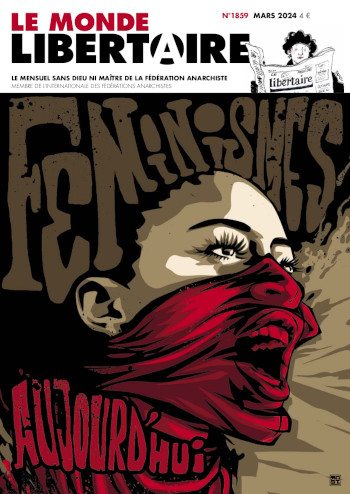Série américaine. Chapitre III : Mutinerie high-tech
mis en ligne le 17 mars 2011
On connaît l’importance du complexe carcéral dans le système répressif nord-américain. Près d’un jeune Noir sur deux a eu affaire à cette vaste machine de contrôle social qu’est la prison. Aujourd’hui, les difficultés de financement des États et la désorganisation bureaucratique ont des retombées sur le fonctionnement des prisons. En Californie, la libération d’un nombre important de détenus est prévue ou est déjà en cours, cela afin de réduire le coût des administrations pénitentiaires. En attendant, les conditions d’incarcération se dégradent rapidement.C’est dans ce contexte qu’éclate dans l’État de Géorgie, le 10 décembre 2010, une grève des prisonniers de sept grands pénitenciers, lesquels refusent de travailler et de cantiner jusqu’à la satisfaction de leurs revendications. Ils demandent une alimentation améliorée, une hausse de la rémunération du travail, une révision du système des punitions ainsi que de meilleures possibilités de formation et d’étude. Dans une période de résignation et d’atomisation, l’éclosion de ce mouvement est un fait remarquable. Tout d’abord par son auto-organisation horizontale, utilisant un réseau de contacts activé par le téléphone mobile. Signe de sa détermination, le mouvement a dépassé les fortes barrières raciales qui existent à l’intérieur des prisons. Un communiqué des mutins transmis à la presse le souligne : « Nous avons réussi à nous unir en dépassant toutes les différences qui nous séparent, Blancs, Noirs, ainsi que celles exacerbées par l’appartenance à des gangs. »
Dans chaque dortoir, un prisonnier est en contact avec le réseau et répercute les informations. Les portables sont interdits dans les prisons mais on estime qu’environ 10 % des prisonniers en possèdent. Ils les achètent aux gardiens, un téléphone de 20 dollars coûte 400 dollars en prison… L’administration pénitentiaire a aussi été surpris par le choix de formes d’action pacifiques, les mots d’ordre des grévistes incitant à éviter la confrontation physique avec les matons. À l’extérieur, le mouvement a trouvé des relais chez d’anciens militants des Black Panthers. Preuve que la mémoire des luttes passées n’a pas tout à fait disparu dans la communauté noire nord-américaine, pourtant si fortement meurtrie par la pauvreté, le chômage et la détresse.
Les sans-abri aux portes de Berverly Hills
Une économie dont la prétendue « reprise » ne règle pas la question du chômage reste vulnérable. Lord Keynes lui-même s’en était inquiété dans les années 1920, au point de noircir des pages pour avertir les classes dirigeantes du danger social d’une telle logique. Preuve de l’inaptitude du capitalisme privé à surmonter ses crises, une telle stagnation était, pour lui, porteuse de grandes incertitudes et possibles bouleversements sociaux, menaçant le système dans ses fondements. Sept décennies plus tard, les recettes interventionnistes du même Keynes semblent épuisées, et nous voilà revenus à la même problématique : l’incapacité du capitalisme à engendrer par lui-même un volume d’investissement suffisant pour réaliser le plein emploi. Pour le moment, et aux États-Unis en tout cas, les exclus s’y résignent. Mais pour combien de temps ?
Regardons maintenant le cas de Los Angeles. Personne ne s’attend à trouver de la pauvreté dans le quartier de Beverly Hills. Pourtant il y a péril en la demeure. Los Angeles est aujourd’hui considérée comme la capitale des sans-abri aux États-Unis. Plus de 50 000 personnes y vivent dans la rue, dont 6 000 anciens combattants des guerres de l’Empire. Une façon cavalière de remercier ces hommes qui se sont battus pour la défense du rêve américain. Heureusement, ces personnes se concentrent dans les quartiers sud de la ville, à Skid Row, laissant les riches de Beverly Hills tranquilles… Le rouleau compresseur de la crise, la montée de la pauvreté, les expulsions immobilières qui se poursuivent, tout contribue à ce que le nombre de personnes vivant dans la rue continue d’augmenter, ici, comme partout ailleurs, dans le pays le plus riche du monde.
Le climat doux de Los Angeles explique en partie que la ville attire autant de pauvres. Des « spécialistes » avancent une explication plus cynique. Alors que, dans des centres comme New York, la densité du tissu urbain rend immédiatement visible la pauvreté, à Los Angeles, l’étendue de la ville et le fait que les déplacements se font surtout en voiture individuelle, la rend invisible. « On peut se lever le matin, aller sur son lieu de travail, revenir le soir et ne jamais croiser un sans-abri », avance un bureaucrate local. Quel soulagement ! Dans un souci de préservation des « potentialités touristiques de la ville » (sic), la mairie tente tout de même de parquer ces personnes dans des logements de fortune (est-ce le bon mot ?) situés dans des zones réservées, éloignées de la vue du citoyen lambda ou du touriste de passage. Comme cela se fait aussi à New York, Boston, Atlanta.
Malheureusement, pour passer de la proposition au concret, il faut des moyens financiers qui manquent dans les villes aujourd’hui proches de la faillite. Ainsi, dans l’attente du retour au plein-emploi dont rêvait Keynes, les chômeurs, les précaires, les travailleurs pauvres à la rue de Los Angeles, continueront à survivre dans une invisibilité désordonnée plutôt que dans l’invisibilité rangée.
La mafia du plan de relance…
Qui n’a entendu parler du programme de relance de l’économie lancé par l’administration Obama ? On sait désormais que, pour l’essentiel, il se résume dans le refinancement du système bancaire avec des fonds publics, c’est-à-dire, en réalité, une augmentation de la dette publique.
Motivés par un humanitarisme naïf, certains ont insisté sur des mesures secondaires tels les projets censés relancer l’industrie du bâtiment par la réhabilitation de l’habitat pauvre des grandes villes, les grandes cités de logements publics ou municipaux. Un ami, ayant fait des études d’urbanisme et habitué des petits boulots, a trouvé justement du travail dans le nouveau service créé pour mener à bien ce projet de réhabilitation dans la ville de New York. Leur première tâche aurait dû consister à recenser les immeubles et les logements à réhabiliter. Mais non, on a sous-traité le travail à des entreprises privées (déjà connues de la mairie).
Une année s’écoule, la liste des logements à rénover est enfin disponible, les travaux peuvent démarrer sur des logements que, soit dit en passant, personne du service officiel n’a réellement visités… Et à qui faut-il attribuer les sommes de réhabilitation et en fonction de quels devis ? Faut-il ouvrir marché et faire jouer la concurrence, comme disent les prophètes ? Pas si simple ! Le service où travaille notre ami reçoit de la mairie, une deuxième liste, celle des entreprises autorisées à travailler sur le parc de logement municipal, entreprises ayant signé la convention collective du bâtiment. Ce qui est tout à fait convenable, car Obama tient à montrer patte blanche auprès des bureaucrates syndicaux. Il faut ici faire une courte parenthèse en rappelant que la majorité des syndicats du bâtiment du grand New York a des liens étroits avec la mafia. Et c’est donc à ces entreprises que les sommes destinées à la réhabilitation doivent impérativement être attribuées, lesquelles, après avoir empoché une grasse fraction au passage, les distribuent à des sous-traitants.
À la fin, la réhabilitation sera réalisée par des travailleurs illégaux à des tarifs misérables, utilisant des matériaux de mauvaise qualité. Un an et demi s’est écoulé, soit la moitié du temps prévu pour le plan de réhabilitation. Notre ami et ses collègues n’ont toujours pas vu les logements à réhabiliter et ils ne les verront pas après réhabilitation. La rumeur dit qu’ils n’existent peut-être pas… En attendant, et avant que les travaux commencent, plus de la moitié des sommes prévues pour le programme a déjà été dépensée dans ce fonctionnement bureaucratique et dans l’arrosage des divers sous-traitants. Les États-Unis, pays de la libre entreprise et de la concurrence, est en réalité un pays de bureaucraties tentaculaires au service du privé, avec des ramifications mafieuses. Ici comme dans le secteur bancaire, le programme de relance n’est qu’une redistribution de l’argent public au bénéfice de secteurs particuliers de la classe capitaliste.
…et les ayatollahs du Tea Party
Oui, le Tea Party dans tout cela, me direz-vous ? Dans l’importance et la visibilité donnée à la montée de la droite conservatrice, il y a une dimension médiatique.
Quelques milliers de militants du Tea Party manifestant à Washington attireront une plus grande couverture médiatique que les dix milliers de militants du Forum social réunis à Detroit, que les quelques milliers d’activistes qui imposent la fermeture d’une centrale nucléaire dans l’État du Vermont. Cela étant dit, ce serait une erreur d’ignorer la vague de fond de la droite conservatrice. Le Tea Party en est l’expression politique, mouvement qui intègre les valeurs politiques et religieuses de la droite traditionnelle. Il intègre aussi des idées racistes qui fondent la société américaine, ravivées aujourd’hui par une féroce xénophobie anti-immigrés. C’est également dans le cadre du Tea Party qui s’exprime le désarroi et l’angoisse de tous les citoyens troublés par l’effondrement de l’Empire. Tous ceux qui, plus ou moins consciemment, sentent que les États-Unis n’ont plus les moyens économiques d’assurer leur place dominante dans le monde. Qui se voient menacés de l’extérieur et de l’intérieur. L’isolationnisme inhérent à l’histoire de la société nord-américaine réapparaît comme une réponse à ces inquiétudes. Tout cela se manifeste, sous une forme confuse, au sein d’un courant où l’on perçoit l’État fédéral comme une institution totalitaire menaçant les droits individuels – où l’on trouve parfois une critique juste de la logique bureaucratique de l’État moderne. Par exemple, lorsque les membres du Tea Party s’insurgent contre la proposition du plan de santé Obama, imposant à tout un chacun la souscription d’une assurance privée de santé à partir de 2014.
Le Tea Party, aujourd’hui avalé par le puissant appareil du parti républicain, a canalisé vers le terrain institutionnel, électoraliste, des mouvements de base de la droite qui vont ainsi être vidés de leur énergie. Il a repris à son compte, et en partie, les pratiques d’agitation et de mobilisation qui furent celles du gauchisme nord-américain des années 1960. Un peu comme le fit le Front national par rapport aux groupuscules de l’extrême droite française militante. On assiste à une intégration de l’extrême droite dans le système. Mais cette intégration est loin d’être achevée, et la capacité de résistance de ces groupes à la machine institutionnelle dépend pour beaucoup des conséquences sociales de la crise en cours.