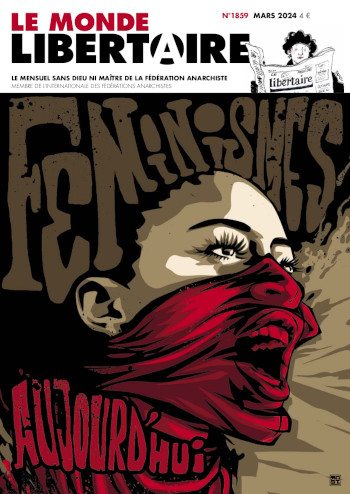Horreur et best-seller
mis en ligne le 14 février 2013
Nous vivons dans une société où les récits des guerres aussi bien que les récits des génocides jouent un rôle important dans la fabrication du consensus social et culturel. Quand un livre paraît qui remet en cause cet état de fait, il est purement et simplement ignoré, c’est le cas du livre de Charlotte Lacoste 1.La « grande » guerre
Commençant par l’examen précis des textes de fictions évoquant la guerre de 1914-1918 et leur comparaison avec les témoignages de poilus, elle se penche très rapidement sur le cas des Bienveillantes de John Littell, un livre épais de plus de 900 pages qui prétend explorer la conscience d’un responsable SS de la réalisation du génocide juif.
Avant cela, l’auteure compare les récits des témoins de la guerre de 1914-1918 aux romans qui suivirent. Elle explique comment ces derniers transformèrent cette atroce boucherie en objets littéraires enthousiasmants. Le saut chronologique, auquel elle se livre de la Grande Guerre aux récits concernant les heures noires de 1939-1945, n’est pas un artifice de style. Il s’agit pour l’auteure de montrer que dans un cas comme dans l’autre les témoins sont muselés afin que le vrai visage de la guerre, telle qu’elle a été vécue, n’apparaisse pas. Pour ces derniers, la fonction profonde du conflit est de détruire physiquement comme psychiquement autant les perdants que les vainqueurs, autant les victimes que les bourreaux. C. Lacoste démontre que ce type de récit n’est pas vendeur, après la guerre de 1914-1918 comme aujourd’hui.
Face aux Bienveillantes, Charlotte Lacoste fit ce que peu de critiques ont pu faire, faute de temps et de courage, à savoir lire ce livre jusqu’au bout. Le compte rendu qu’elle publie relève d’un travail de médecin légiste. Son scalpel ne laisse aucun endroit entier. Il ne s’agit pas ici de redire ce qu’elle énonce avec tant de rigueur et de précision, mais de profiter de l’occasion pour aborder, une fois et certainement pas la dernière, les raisons qui font le succès du livre Les Bienveillantes tiré à plus de 700 000 exemplaires.
Un homme ordinaire
Le héros de Littell étant un clone d’Adolph Eichmann, il était important de se replonger dans cette histoire. En 1961, le procès du SS à Jérusalem attire enfin l’attention mondiale sur le génocide juif. Hannah Arendt en a rendu compte dans Eichmann à Jérusalem rassemblant ses articles de correspondante de presse. Le sous-titre de cet ouvrage, La banalité du mal, deviendra malgré elle une expression passe-partout, détournée, afin d’éviter le questionnement.
Charlotte Lacoste revient sur le sujet avec précision. Elle démontre que H. Arendt ne considérait pas Eichmann comme un homme ordinaire. La philosophe dit qu’il n’était même pas « un criminel ordinaire », bien loin de là, et suggère que « par endroits il frôle la démence ». Le mal n’était banal que pour Eichmann lui-même. Mais le sous-titre eut du succès, fut repris et appliqué à tout un chacun. La critique comme les commentateurs reprirent cette idée que tout individu était susceptible un jour d’être à son tour un bourreau. Cette assertion venait renforcer le relativisme ambiant qui énonce encore aujourd’hui qu’il n’est plus possible de dire ce qui est bien ou mal, tout se valant. C’est justement ce discours qui est, selon Charlotte Lacoste, présent tout au long du livre de J. Littell et qui en fait le succès. Pour passer dans la pensée commune, ce discours a besoin de la fiction. Le témoin ne parle que de ce qu’il a vu et dans ce cas ce ne peut être que partiel, et peu attirant pour le client lecteur et pas assez pour l’éditeur. L’historien de son côté se fonde sur des faits, des archives, d’autres travaux historiques et tente des analyses qui peuvent être discutées. La fiction, elle, a l’avantage d’ouvrir le champ à l’imagination. Elle permet d’ajouter des éléments qui donnent de l’épaisseur aux personnages. Que le héros de Littell soit homosexuel refoulé, amant de sa sœur, connaisseur de l’antiquité grecque et des grands auteurs, etc., n’a que peu de rapports au fond avec les massacres qu’il commet. On peut ainsi en faire quelqu’un de fort commun, et faire par la même occasion d’un tueur quelqu’un dont on ne peut que se sentir proche, qu’on le veuille ou non.
La banalité du mal
Cette « banalité du mal » est bien commode pour les tenants de l’ordre moral. Elle justifie l’existence de pouvoirs qui disent et le droit et la morale et qui éventuellement punissent. Charlotte Lacoste, utilisant l’outil créé pour le livre de Littell, montre qu’il s’applique parfaitement aux comptes rendus romancés du génocide rwandais. De même pour ce qui concerne le génocide khmer. Il suffit pour s’en rendre compte de lire la chronique d’une journaliste de Télérama (n° 3219, 18 au 24 septembre 2011) à propos d’un livre publiant les actes du procès des bourreaux Khmers rouges. Elle écrit « ce qu’un homme a fait, tout homme peut le faire – et même à travers lui, ce crime, tous les hommes l’ont commis ».
Cette « banalité du mal » est aussi bien commode pour absoudre par avance les bourreaux car au fond ils ne sont que des hommes qui ont été jusqu’au bout de leur humanité puisque, pour les bourreaux et ceux qui les mettent en scène, l’homme est par nature mauvais. Cette banalité a aussi pour conséquence la totale et incroyable confiance du metteur en scène (écrivain, interviewer ou cinéaste) dans le récit du bourreau, comme si lorsque l’assassin (quel gros mot !) se met à parler il ne pouvait que dire la vérité. Déjà René Fugler, dans son article sur ceux qui refusèrent le rôle de tueur de masse sur le front oriental de 1939 (in Réfractions, n° 24), avançait ceci : « Alors que le refusant renonce à toute déclaration morale ou humanitaire, le tueur développe un discours de rationalité et de légitimité. »
Tout cela pose en fait deux questions : les raisons profondes de la mise en œuvre de tels massacres, d’abord, les modalités du refus, ensuite. La première, lancinante, n’est toujours pas résolue, comme si une seule réponse était possible, et l’on a vu que la banalité du mal au fond cherchait à cacher la seconde. Se demander ce qui fait que l’on participe non seulement à un conflit armé mais aussi à sa systématisation à travers des massacres de masse et y répondre par les trois mots qui constituent l’expression « banalité du mal » a pour objet de ne pas chercher à comprendre pourquoi beaucoup s’y sont refusés. Enfermés dans la litanie officielle du « de mémoire », journalistes, commentateurs, écrivains, cinéastes prônent en fait la soumission aux ordres comme étant quelque chose de naturel. Ceux qui, activement ou passivement, ne se plient pas apparaissent comme des inadaptés sociaux et les témoins de l’horreur comme des oiseaux de mauvais augure incapables de raconter une histoire avec un certain ressort. Ce qui amène ces mêmes commentateurs à détourner le sens des expériences de Milgram sur la soumission aux ordres, qui datent d’une cinquantaine d’années. Charlotte Lacoste consacre plusieurs pages à illustrer ce détournement. Il fallait faire de l’obéissance aux ordres une addiction au mal et faire passer la responsabilité des donneurs d’ordre aux obéissants et ainsi évacuer le problème de la soumission à l’autorité. Elle rappelle que Milgram, cinq années après la publication de son livre (1974), rappelait que « la résistance à l’autorité malveillante doit être enracinée dans l’action collective si elle veut être véritablement efficace ».
Du Silence de la mer à La Chute
La virulence assumée et justifiée de Charlotte Lacoste l’amène à s’affronter ensuite au monument des monuments de la littérature de la résistance, Le Silence de la mer de Vercors. J’avoue y avoir pensé en commençant cette lecture et tout à la fois espéré ne pas y être confronté. Cet officier allemand qui vient chez le narrateur occuper son espace vital pendant six mois, est tout comme le « héros » de Littell un homme cultivé, civilisé. Cela suffit-il pour faire le procès du livre ? Probablement. Arendt avait déjà montré l’inculture foncière d’Eichmann. Les témoignages historiques portant sur les SS montrent que ceux-ci ne se distancièrent en rien de l’autodafé permanent que fut l’État nazi. Pourtant, et ce ne fut pas un mythe, il exista dans l’armée allemande une résistance des professionnels à l’emprise des nazis, des hommes qui faisaient la guerre parce que c’était leur métier. Ceux qui, à la fois écœurés de cette boucherie et conscients de la défaite à venir sur le front russe tentèrent de résister, payèrent d’un prix fort leurs velléités de résistance tout comme leur amateurisme dans ce type d’entreprise. Charlotte Lacoste toute à son élan de déconstruction du récit du bourreau de fiction, oublie alors de remettre en cause les soldats qui permirent, par leur propre soumission au chef, que les bourreaux accomplissent leur œuvre. De la même façon, le jugement qu’elle porte sur le film La Chute qui met en scène les derniers jours de Hitler dans son bunker à Berlin, me semble absurde. Il n’y a là nulle glorification du Führer et de ses sbires mais une parfaite illustration de ce que fut la démence nazie, au moins pour celui qui sait regarder. Je ne peux m’empêcher de penser à ce docu-fiction sur la conférence de Wannsee où l’acteur anglais Kenneth Branagh incarne Heydrich, le metteur en acte de la Shoah. Les dialogues n’étant que la retranscription de la seule copie du procès-verbal de cette conférence. Nulle condescendance dans ce film, nulle héroïsation, juste l’horreur de la bureaucratisation de la liquidation de millions de gens.
Par la précision de son réquisitoire, Séductions du bourreau plonge le lecteur dans ce que justement il voulait éviter : le récit de l’horreur. Il l’oblige aussi à entendre la complainte du bourreau qui va partout expliquant qu’il a fait tout ça à son corps défendant, qu’il est la vraie victime de ce monde qui ne veut pas l’entendre. Au fond, le monde ne lui est pas reconnaissant d’avoir effectué pour lui cette tâche nécessaire.
Tous coupables, pas de responsable
Le discours dominant veut que l’on ne cherche à lutter contre le « mal » que dans la mesure où on a été le chercher en soi. Curieuse inversion des valeurs, retour du religieux refoulé, du mea culpa généralisé dont le résultat pervers est l’acceptation du bourreau comme punition de notre propre incapacité à être innocent.
Cette supposée coresponsabilité dans l’exécution des génocides est à l’œuvre dans beaucoup plus de domaines que ne le laisserait penser cet ouvrage. Nous sommes coresponsables de la crise économique, donc nous devons tous payer pour nous en sortir. Nous sommes coresponsables de la situation écologique du monde, nous sommes tous dans le même bateau, etc. Comme nous sommes tous des criminels en puissance, cela justifie l’hypothèse de l’existence d’une lutte pour la vie où seuls les plus forts – les plus tueurs – survivent. Par conséquent, l’existence d’un État fort capable de préserver les plus faibles – les moins tueurs – se justifie et permet d’organiser la chasse aux divergents de tout poil.
L’accueil fait au livre de Charlotte Lacoste fut plus que réservé. Il est clair que quelqu’un qui dit « pour ceux qui considèrent la solidarité comme un attrape couillon, la véritable solidarité est dans le mal » ne peut recevoir que peu de marques de sympathie. Elle a la nôtre.
1. Séductions du bourreau, négations des victimes, 480 pages, 2010, Puf, collection « Intervention philosophique ».