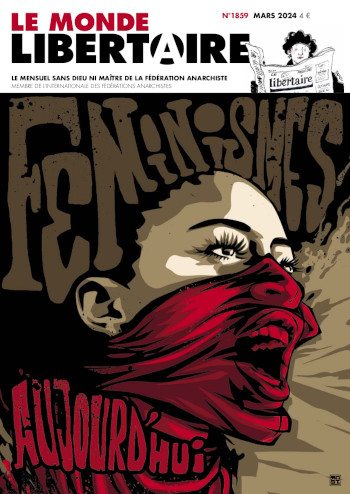Qu’allaient-ils faire dans cette galère ?
mis en ligne le 26 janvier 2012
Les grands chefs syndicaux au sommet social du 18 janvier dernier convoqué par Sarko ?Si l’on en juge par les résultats, leur présence à ce show présidentiel très médiatisé tient plus du faire-valoir que de l’action syndicale, même très réformiste : 430 millions d’euros de mesures concernant le chômage partiel, la prise en charge totale des « charges sociales » pour les jeunes de moins de 26 ans embauchés dans des toutes petites entreprises, les « mutations économiques » (aides à la reconversion) et la formation des chômeurs et le renforcement des effectifs de Pôle emploi. Précisons que ces 430 millions sont des crédits « redéployés », c’est-à-dire piqués sur d’autres budgets, sociaux ou autres ! 430 millions, une peccadille face aux dizaines de milliards miraculeusement trouvés, parfois en moins d’une semaine, pour renflouer les caisses de telle ou telle banque ou de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel État…
Sarko a précisé, lors du sommet, qu’il annoncerait à la fin du mois les vraies mesures, celles qui cognent (TVA sociale, réforme radicale de la formation professionnelle, etc.).
En première analyse donc, cinq heures perdues pour Bernard, François, Jean-Claude… Ce qui en soit n’est pas très grave. Mais, à y regarder de plus près, ce sommet social avait un tout autre objectif que de négocier quoique ce soit. Il s’agissait d’aboutir à un « diagnostic partagé » dans la logique désormais institutionnalisée de « dialogue social ». Dialogue social, bel habillage pour ne pas dire accompagnement actif ou passif des mesures gouvernementales, voire de plus en plus co-élaboration de ces mesures. On se met d’abord d’accord sur le constat (il y a une crise du système, va bien falloir que les salariés, les chômeurs paient la note ; il faut garder en mémoire le communiqué hallucinant de l’intersyndicale, sauf FO, du 18 août 2011). Puis, on met en œuvre la meilleure stratégie pour les faire avaler aux salariés y compris en faisant mine de résister.
Soyons clairs, rien ne s’est fait ces dernières années sans l’accord explicite (direction de la CFDT) ou implicite (direction de la CGT). Plus précisément, la « position commune » (c’est leur propre terme) d’avril 2008 – CGT, CFDT et MEDEF, le tout avec la bénédiction de Sarko – a marqué un tournant dans le processus d’intégration des organisations syndicales qui a commencé depuis longtemps mais qui se heurte à une résistance, réelle celle-là, d’une grande partie des militants.
Comment la loi Fillon sur les retraites aurait-elle pu passer, à l’automne 2010, sans l’axe Thibault-Chérèque qui a promené les salariés de manif en manif en cassant toutes les tentatives de blocage et de grève de leurs propres « troupes ». On se souvient, là encore, du sinistre communiqué CGT, CFDT, FSU, Unsa condamnant les « atteintes aux biens et aux personnes » au moment où les salariés des raffineries tentaient de bloquer l’économie.
Comment les multiples réformes de destruction de l’école, dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (réforme des lycées, école du socle, mastérisation, liquidation de l’enseignement professionnel au profit de l’apprentissage, privatisation des Greta) auraient-elles pu se mettre en place sans l’accord inavoué, bien évidemment, de la direction de la FSU, encore largement majoritaire dans le secteur même si elle a perdu 100 000 voix aux élections professionnelles du 20 octobre dernier ? À noter que la grève (SNES, CGT, SUD, FO) et la manifestation nationale du 31 janvier sur des bases claires (retrait pur et simple du projet de décret sur l’évaluation des enseignants et annulation des suppressions de postes) est un point d’appui que la FSU (contre certains de ses propres syndicats !) fait tout pour saper.
Comment 860 salariés de SeaFrance à Calais pourraient-ils se trouver mis à la rue par l’État (propriétaire de la SNCF, elle-même propriétaire de l’entreprise) sans le soutien actif de la direction de la CFDT qui pousse même à l’exclusion de sa propre section locale qui n’est pas dans la ligne de soumission et de trahison de sa confédération ?
Et si certains n’étaient pas encore convaincus par ces exemples, qu’ils lisent l’appel paru à la mi-décembre « pour un nouveau contrat européen » signés (avec quelques homologues d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et de Belgique) par le couple Chérèque-Thibault. Ces « syndicalistes », qui feraient retourner dans leur tombe tous les anciens, s’inquiètent une fois de plus de l’« avenir de l’Union européenne » et donc de sa monnaie, s’engagent à trouver des solutions pour « réduire les déficits » et rappellent, s’il en était besoin, qu’ils ne « défendent pas une position partisane » (en clair les salariés !) mais qu’ils cherchent « l’intérêt général », donc à préserver le système capitaliste. Faut-il en rajouter ?
Tout cela pourrait être déprimant et faire aboutir à de mauvaises conclusions du type : tout est pourri, abandonnons le terrain syndical. J’ai la faiblesse de penser que c’est tout le contraire qu’il faut faire. Se réapproprier notre outil syndical, qui peut être un levier puissant de transformation sociale dans ses acquis et dans ses pratiques qui s’opposent à l’impasse électorale où le système tente de nous enliser.
Définissons les revendications à la base qui deviennent les mandats des sections, décidons des modalités d’action à la hauteur des coups qui nous sont portés, faisons vivre l’inter-professionnel, bousculons les bureaucraties en imposant les mandats, discutons et organisons-nous entre militants qui se reconnaissent de la lutte de classe et qui sont sans arrière-pensées électoralistes ou partidaires. C’est notre tâche urgente. C’est notre responsabilité. Et la galère va changer de côté.
COMMENTAIRES ARCHIVÉS
julien bézy
le 29 janvier 2012
Dans ces trois derniers mois avant les élections on aura beaucoup d'effets d'annonces.