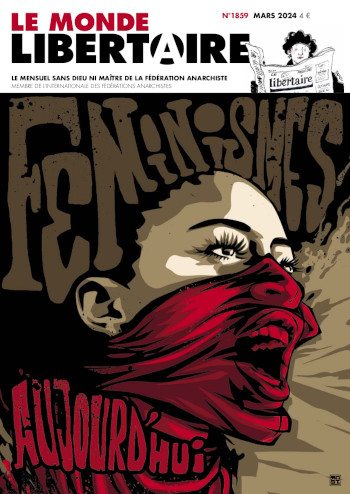Thaïlande : sombre horizon des réfugiés
mis en ligne le 17 mai 2012
Une visite du camp de réfugiés de Mae La « Touristes » : bonne réponse à donner aux militaires thaïlandais contrôlant les checkpoints de la route menant à Mae La depuis Mae Sot, ville-frontière entre la Thaïlande et le Myanmar voisin. C’est que, depuis peu, les guides Lonely Planet, qui ne s’encombrent guère de préoccupations éthiques – rentabilité oblige –, n’hésitent plus à conseiller la route aux touristes de passage dans la région.
Après une cinquantaine de kilomètres en deux-roues, nous atteignons Mae La, « refuge temporaire » depuis près de trente ans. C’est le camp de réfugiés le plus important de Thaïlande, qui en compte sept sur sa frontière occidentale.
Les 40 000 occupants de Mae La sont pour la plupart des Karens, population de l’est du Myanmar (ex-Birmanie) ayant fui les combats entre l’aile armée du KNU (Karen National Union – parti politique luttant pour l’autonomie Karen au sein d’un État fédéral) et l’armée birmane –, et les atrocités commises par cette dernière.
Après s’être vus refoulés une première fois (« pas de touristes », cette fois) à l’une des entrées officielle, nous pénétrons dans le camp cinquante mètres plus loin, nous faufilant entre les barbelés censés en empêcher l’accès. Facile : les habitants les franchissent jour et nuit pour aller travailler à l’extérieur, couper du bois, cueillir quelques plantes.
Le camp, ensemble de huttes construites à la va-vite au pied d’une colline, en terrain accidenté, est traversé par une piste de 4 km, et découpé en trois zones, de cinq sections chacune. La terminologie utilisée n’est pas sans évoquer celle des lieux de détention. Le tout ressemble à une bourgade pauvre d’Asie du sud-est, rizières et champs cultivés en moins, barbelés en plus.
Mae La possède ses commerces, ses gargottes, ses espaces internet payants ; son hôpital, ses écoles, ses églises (les Karens sont majoritairement chrétiens) et ses temples ; sa prison. Et ses inégalités : une moto, une télévision, et de l’argent à dépenser pour les plus aisés. Pas grand chose pour le reste : les maisons sont à peu près vides.
Le visiteur est frappé par le dénuement des habitants du camp, et peut-être davantage encore par l’atmosphère d’ennui, d’attente interminable. Quoi de pire, pour un paysan asiatique habitué au rude labeur des rizières de plaine ou de montagne, que de végéter au milieu de ces longs chemins de terre ne menant nulle part ?
Tous espèrent quitter Mae La le plus vite possible. Mais on ne se fait plus d’illusions sur les possibilités d’accueil à l’étranger. Et le retour au Myanmar, si la situation politique s’améliore, reste hypothétique. Certains vivent ici depuis presque trente ans. On y naît, on y vit et on y meurt 1, dans cet entre-deux sans horizon, qui engloutit les rêves sous la résignation.
Les 20-30 ans ont la possibilité, pour des salaires de misère, de travailler à l’extérieur, illégalement. Risquant la reconduite à la frontière en cas d’arrestation, ils peuvent ainsi fournir aux familles du camp les revenus qui leur permettront de se procurer de l’eau potable (payante) ou quelques affaires dans les commerces du camp. L’eau de douche se tire au puits (ouvert deux fois trois heures par jour). Les rationnements mensuels contiennent pour l’essentiel riz, haricots, sauce de poisson, huile, sucre… Le reste doit être acheté, ou provient des minuscules jardins, cultivés près des huttes, et de la forêt environnante.
Deux cents volontaires et employés d’organisations humanitaires occidentales fréquentent Mae La en semaine, arrivant de la ville le lundi matin dans des 4 x 4 japonais devenus, depuis l’invasion du Cambodge par les ONG en 1992 2, tout un symbole.
Les camps de réfugiés de la région attirent depuis les années 1970 une population diverse d’« humanitaires » : spécialistes (hygiène, santé, etc.), professeurs diplômés ou improvisés, missionnaires, touristes 3.
Depuis quelques années, les critiques sur l’action des ONG abondent. Les principales portent sur leurs coûts de gestion démesurés, les salaires mirobolants de certains employés, ou le manque de préparation des équipes. La méconnaissance des principes de fonctionnement élémentaires des communautés prises en charge mène fréquemment, sur le terrain, à des échecs patents. Également dénoncés : la verticalité de la prise de décision, l’absence de volonté de passer le relai aux communautés dans la gestion de leurs problèmes, ou des fonctionnements répondant davantage à des logiques internes qu’aux besoins des populations concernées.
À Mae La, depuis des années, des dizaines de victimes de mines anti-personnel attendent des fauteuils roulants maintes fois promis.
Nous rencontrons un jeune Britannique, décontracté, qui tient à évoquer son expérience sur place. Fraîchement débarqué en Thaïlande, il enseigne l’anglais aux enfants de Mae La dans le cadre d’une mission d’ONG de quelques semaines. Il n’a ni diplôme ni expérience, ne parle ni birman, ni karen, ni thaï, et semble peu au fait des réalités sociales de la région.
Perçoit-il un salaire ? La réponse fuse, comme une évidence, soulignant l’incongruité de la question : « Bien sur, on ne peut pas travailler pour rien, si ? ».
Et nous en croiserons bien d’autres, sur les routes d’Asie du sud-est, de ces purs produits du conformisme occidental, les notions d’« expérience » et de « CV » sans cesse à la bouche, enrobés de quelques formules plates, vaguement philanthropiques.
Peu friands de contacts avec les missionnaires du coin et sentant quelques soupçons liés à la présence de deux étrangers dans le camp (Mae La a ses espions et ses informateurs), nous quittons le camp-prison aussi facilement que nous y sommes entrés. Drôle d’impression : la plupart de ses occupants, en dix, vingt ans, n’a guère eu l’occasion de sortir de ce lieu oublié du monde, en périphérie de la vie. 4 km2 pour horizon, entre une route isolée et une colline vierge de végétation depuis longtemps.
Thaïlande et réfugiés
La Thaïlande fait preuve, depuis les années 1980, d’une certaine bienveillance envers les réfugiés Karens – conséquence d’anciennes alliances entre gouvernement thaïlandais et guérilla Karen dans le cadre de la lutte anti-communiste des années 1970-1980.
Les réfugiés sont donc tolérés, dans les camps, tant qu’ils coûtent peu à l’État et que s’en occupent (au moins financièrement) les ONG. Mais, à mesure que les rapports Thaïlande-Myanmar évoluent, les menaces de rapatriement pèsent sur ces exilés.
Le traitement habituellement réservé par l’État thaïlandais aux réfugiés des pays voisins est ce qu’on fait de pire en la matière : rapatriement forcé de 40 000 cambodgiens en zone minée en 1979 4 ; bombardement du camp de Nong Chan (100 morts) la même année 5 ; non-assistance aux dizaines de milliers de boat people vietnamiens dans les années 1980, abandonnés aux atrocités des pirates locaux 6. Et plus récemment : boat people Rohingyas (minorité apatride du Myanmar) repoussés en mer en janvier 2009 ; expulsion de 4 000 Hmongs (minorité persécutée par le régime communiste du Laos voisin) en décembre 2009 ; rapatriement forcé de nouveaux arrivants Karens du camp de Tha Song Yang en février 2010.
Malgré des pressions internationales périodiques, les gouvernements thaïlandais successifs n’ont jamais semblé soucieux de régler la question des réfugiés une fois pour toutes. Les ONG, de leur côté, ne montrent pas la volonté d’œuvrer en ce sens – la bonne entente avec les gouvernements en place étant souvent la condition principale de leur présence sur place.
Des solutions sont pourtant aisément imaginables : octroi d’un statut spécial permettant aux réfugiés de se déplacer librement et de travailler dans le pays ; délivrance de cartes d’identité thaïlandaise ; accords internationaux pour relogements à l’étranger.
Le nombre de réfugiés actuellement présents sur le sol thaïlandais n’excède pas une centaine de milliers –contre deux à trois millions de travailleurs migrants.
Les migrants : parias de Thaïlande
Les travailleurs clandestins (birmans, cambodgiens et laotiens) constituent le sous-prolétariat thaïlandais. Sans statut et sans droits : le rêve des économies dont le dynamisme repose sur l’exploitation d’une main d’œuvre à prix minime.
Les salaires des migrants sont de deux à quatre fois moins élevés que ceux des Thaïlandais, déjà très bas (le salaire minimum légal varie selon les provinces : de 6 à 7 euros par jour en moyenne ; les avantages sociaux sont, en règle générale, faibles).
Des pans entiers de l’économie ont recours à cette force de travail idéale : bâtiment, pêche, agro-alimentaire, restauration, commerce, industrie, etc. Elle est majoritaire dans certains secteurs : dans une société de plein-emploi, le prolétariat thaïlandais, remplacé au bas de l’échelle sociale, préfère trimer ailleurs.
Les politiques à l’égard des migrants sont, sur le papier, fluctuantes. Les associations de défense des droits humains tentent régulièrement de faire pression sur le gouvernement pour faire enregistrer les clandestins, leur assurer un statut légal, et mettre fin à leur situation d’extrême précarité.
Des mesures récentes ont été prises dans ce sens, mais la complexité des démarches à suivre, le coût des procédures, et les difficiles rapports qu’entretient un État birman paranoïaque avec ses « citoyens » rendent une régularisation massive impossible. Et la Thaïlande a du mal à renoncer à cette masse de main d’œuvre corvéable à merci, génératrice d’importants profits.
Les besoins en main d’œuvre étrangère sont considérables ; le fait n’empêche pas la lutte contre les travailleurs illégaux, régulièrement à l’ordre du jour. Le pays a ses quotas d’expulsion, et les reconduites à la frontière vont bon train.
Ceci n’empêche pas l’arrivée massive, quotidienne, de milliers de clandestins. À Mae Sot, les militaires du poste-frontière observent jour et nuit, l’œil vide, ce drôle de manège qui ne surprend que quelques visiteurs de passage.
Ostracisés, les migrants forment une population vulnérable, en proie à tous les abus : racket par la police, les forces armées ou la pègre 7, exploitation sexuelle des femmes dans les réseaux de prostitution, cas d’esclavage sur des bateaux de pêche 8, viols, meurtres. À ce tableau déjà bien noir, il convient d’ajouter les cas d’exploitation par des particuliers ou de petites entreprises (plantations, micro-usines de la sueur), les inégalités de traitement dans les commerces, les campagnes de stigmatisation dans les médias (les étrangers servent fréquemment de boucs émissaires dans les affaires de délinquance), les tracas administratifs, les abandons en situations de crise (tsunami de 2004 9 et inondations fin 2011), les procès bâclés, les condamnations excessives, ou l’horreur des conditions de détention.
Dans une commune du sud du pays, la police oblige même les migrants birmans à revêtir un gilet spécial (payant) sur lequel doit figurer leur nom, leur emploi et leur titre de travail 10. Ceux qui ne portent pas le signe d’infamie sont arrêtés et doivent s’acquitter d’une amende.
Pour ces clandestins, trop compter sur la solidarité locale est un risque que l’on évite de prendre. Soixante ans de propagande nationaliste ont distillé dans les esprits un racisme viscéral à l’égard des populations voisines, au mépris d’une histoire empreinte de diversité et d’échanges. Le quotidien est davantage fait de délations, de chantages et d’extorsions que de manifestations d’entraide entre pauvres. D’après un sondage récent, 80% des thaïlandais estiment que les travailleurs migrants ne devraient pas bénéficier de droits dans leur pays d’accueil. Et moins de 10 % des personnes interrogées déclarent avoir aidé un migrant au travail ou à s’intégrer 11.
Les dénonciations d’une telle situation sont peu fréquentes dans les médias et les rares cas d’exploitation médiatisés donnent rarement lieu à des procès. Dans les cas inhabituels ou des procès se tiennent et ou des condamnations sont prononcées, les failles d’un système de justice notoirement corrompu assurent l’impunité des responsables.
A Mae Sot
Mae Sot, la plus importante des villes-frontières entre la Thaïlande et le Myanmar : carrefour commercial, zone de transit des migrants « économiques », business légaux et illégaux, et lieu d’exil des mouvements autonomistes de « l’autre côté ». Réservoir de main-d’œuvre pour investisseurs et patrons, zone de non-droit d’un sous-prolétariat étranger réduit au silence.
La nuit, le couvre-feu en vigueur distille une atmosphère de ville déserte, livrée à la police, aux militaires et aux trafics. Le jour, besogneuse, Mae Sot a les couleurs et l’ambiance d’une ville birmane, d’où les thaïlandais sont presque absents.
Les informations récoltées au gré des rencontres ne font que confirmer ce que l’on savait déjà. Sur l’avenue Intharakaree, une serveuse gagne 2 500 bath (60 euros) par mois, pour douze heures de travail quotidien. Le tiers du salaire minimum en vigueur. Un peu plus loin, un propriétaire de cantine ambulante peut s’offrir les services d’une employée à tout faire de 13 ou 14 ans, à laquelle quelques gestes agressifs serviront d’instructions. Les repas dans les gargotes de Mae Sot nous resteront plusieurs fois en travers de la gorge.
Les journalistes en exil du Karen Information Center nous disent en détails ce que l’on devine partout : une exploitation sans bornes, ne se limitant pas aux 300 usines du district gardées par des hommes en armes.
Mae Sot ne serait rien sans les migrants. Ils sont cuisinier(ère)s, ouvrier(ère)s du bâtiment, aides à domicile, vendeur(se)s. Ils construisent les routes, triment dans les plantations, les briqueteries ou les champs des particuliers. Pour les plus mal lotis, reste l’infâme décharge à la sortie de la ville, où gamins et vieillards récupèrent le peu qui se vend – le plastique, surtout : 9 baths (15 centimes) le kilo de plastique dur –, pieds nus dans les collines de déchets sur lesquelles sont bâties leurs baraques.
Non loin de là, à Ban Song Khwae, en bordure de la déchetterie, cachées au bout d’un chemin en terre isolé, quelques familles musulmanes travaillent une plantation de maïs. Dans un dénuement certain, sans électricité ni eau courante, ils semblent pourtant survivre moins misérablement que leurs confrères de la ville : à force de débrouille, ils sont parvenus, à l’écart, à construire un semblant de village et de vie communautaire, à l’équilibre précaire. Salaires de 80 bath par jour (2 euros), excursions risquées en ville finissant parfois mal, menaces d’arrestation… en lutte pour la survie, ces hôtes accueillants et généreux nous fourniront une rare note d’espoir dans un univers bien sombre.
Pierre Pellicer
avec l’aide de Budsarin Siangphro
1. Il y aurait dix décès par jour à Mae La, selon le directeur de l’hôpital de la zone C.
2. Pour un regard critique et pénétrant sur l’humanitaire au Cambodge, lire G. Lardennois, Petits carnages humanitaires (l’Insomniaque).
3. De nombreuses ONG proposent depuis peu des missions-découvertes de courte durée, entre voyage en sac-à-dos et actions humanitaires. Elles sont payantes, chères, et souvent financées par des dons que les participants récoltent auprès d’entreprises
démarchées au préalable.
4. Libération, « Preah Vihear, carnage à la frontière », 9 juillet 1979.
5. The Washington Post, « Thais Blamed in Shelling Deaths at Refugee Camp »,
9 novembre 1979.
6. Larry Clinton Thompson, Refugee workers in Indochina exodus, 1975-1982
(McFarland, 2010)
7. Irrawaddy, « Thai police oppression for Burmese Untouchables », 6 avril 2011
8. AFP, « Migrants tell of slavery on Thai fishing boats », 15 septembre 2011.
9. IPS, « Thai compassion for Burmese migrants wears thin », 13 janvier 2005.
10. http://www.ghre.org/en/news/452-burmese-workers-suffer-violation-of-rights-as-thai-police-force-them-to-wear-branded-waistcoats-before-being-allowed-to-travel/
11. Phnom Penh Post, « Migrant worker study reveals mass stigma », 21 juillet 2011.
11. Phnom Penh Post, « Migrant worker study reveals mass stigma », 21 juillet 2011.