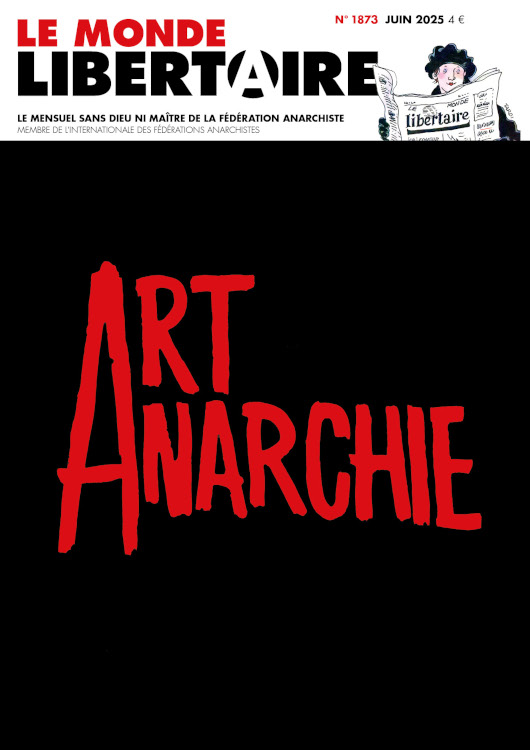Mai, ou, et, donc, le rat noir ?

Il sera beaucoup question d’Histoire en ce mois de mai. Avec tout d’abord en Grèce, avec la découverte du monde des manguès et du rébétiko avec l’autobiographie de Markos Vamvakaris : Moi Markos. Italie : retour fascinant sur l’histoire romaine avec La véritable histoire des douze Césars de Virginie Girod. Enfin, arrêt en France avec deux histoires homosexuelles qui malgré le temps, se font écho. La première : celle de Bruno et Jean au XVIIIème siècle, racontée par Pauline Valade et la seconde plus récente : Quand nos désirs font désordre de Mathias Quéré, durant les années 1970/80.
« Ce qui excuse Dieu, c’est qu’il n’existe pas ».
Stendhal
.jpg)
Markos Vamvakaris : Moi, Markos
.jpg)
Lors d’un concert mémorable à Athènes organisé par la librairie francophone Lexikopoleio, Nicolas Pallier le traducteur en français de Moi, Markos, l’autobiographie remaniée de Markos Vamvakaris (éd. Les Fondeurs de briques), nous a livré quelques clés sur cet ouvrage, issu des deux carnets écrits par Vamvakaris avant la dictature. Ces deux carnets du musicien furent retravaillés et d’abord publiés en grec, grâce au travail mené par Angeliki Vellou-Keil.
Ce n’est qu’aujourd’hui qu’il vient de paraitre, traduit en français. Cette nouvelle version est dédiée au militant anarchiste Marc Tomsin, tragiquement décédé en Crète en 2021, lors d’un accident.
En sus des journaux de Markos Vamvakaris, une fois encore retravaillés, les éditeurs français ont sélectionné et traduit 150 des 250 chansons composées et chantées par le musicien. Pour la plupart de tradition orale et miraculeusement sauvegardées, elles évoquent tous les épisodes de la vie tourmentée de Markos. Mais avant d’entrer dans leur déroulement, il convient de souligner que les compositions de Vamvakaris ont été essentielles dans le développement du rébétiko (dont l’origine à ce jour prête encore à polémique entre les experts). Une musique populaire née à la fin du XIXe siècle et « issu d’un syncrétisme mêlant diverses traditions musicales grecques et byzantines autour du bouzouki », dont Vamvakaris fut l’un des pionniers avant de devenir un virtuose du genre.
Nicolas Pallier a exprimé sa surprise lors de la présentation de la version française du livre à Athènes, en constatant que pas une fois dans son autobiographie, Markos Vamvakaris n’emploie le mot rébétiko « cette musique populaire et urbaine des bas-fonds s’adressant pourtant aux "manguès" ("hommes durs mais droits, bandits au grand cœurs"), et autres marginaux ». A la fin de la présentation, le traducteur nous explique toutes les difficultés rencontrées afin d’essayer d’améliorer le premier récit incomplet qu’en fit Angeliki Vellou-Kiel en grec et « ceci, selon son propre aveu » !
Dans la première partie de son autobiographie, Markos Vamvakaris nous confie : « J’ai eu envie de raconter l’histoire de ma vie et voulu la lire comme si c’était celle d’un autre. Peut-être mon cœur sera soulagé des peines et des colères qu’on a versé en lui, tant d’épreuves que personne n’aurait aimé connaitre ».
C’est dans ce style direct, comme « de pote à pote », qu’il commence son récit à la date du 10 mai 1905, à 3 heures du matin précises. Avant d’évoquer ses années d’enfance passées au sein d’une famille pauvre « mais joyeuse et libre », dans la capitale de l’île de Syros.
Ce témoignage nous donne au passage, de précieux renseignements sur le climat alors plus rude à l’époque, ainsi que sur l’histoire de l’île, majoritairement catholique -(religion minoritaire en Grèce, ce qui marquera durablement Markos)- du fait de la domination vénitienne sur cette île des Cyclades.
Plus avant dans son autobiographie, Vamvakaris va nous faire découvrir encore une mine d’informations sur le petit monde des dockers et des abattoirs grecs dans les îles, secteur peu politisé et dans lequel les syndicats étaient omnipotents.
Il évoquera aussi la grosse vague de réfugiés chassés de Turquie en 1922, etc.
Mais auparavant, il revient sur son enfance et son rapport à l’école qu’il quittera dès l’âge de sept ans. Nous comprendrons plus loin pourquoi. Mais comment va grandir ce gamin « courageux et affranchi, bonne pâte mais au caractère bien trempé et turbulent » ? A découvrir, tous les petits métiers qu’il sera forcé d’exercer pour venir en aide à sa famille et survivre dans une Grèce se relevant difficilement des guerres balkaniques devenue mondiale. Et encore, lorsque âgé de treize ans, après avoir fait « une grosse bêtise », il découvre à peine adolescent la vie sulfureuse du port du Pirée, toujours son bouzouki entre les mains « pour le bouzouki, j’ai tout sacrifié », confiera-t-il plus tard. Il nous explique alors comment il a appris à se défendre dans le monde souterrain des manguès et y a pris goût au haschisch, etc. Comme il le chantera plus tard :
« Je suis un vagabond, moi j’arpente les rues de la ville et à force d’être défoncé, J’ai l’esprit qui part en vrille ».
Nous le suivrons ensuite dans les péripéties qu’il devra affronter lors de son premier mariage « raté » avec sa première femme :
« Compagne de galère, une vilaine mégère. Elle m’avait passé dans le nez un anneau en fer forgé ».
Plus loin, nous allons plonger dans le secret des tékés, ces fumeries de haschich clandestines et y apprendre l’art du narguilé, avant son interdiction sous la dictature de Metaxas. Et quid dans cet univers du rôle joué par la police et ses mouchards ainsi que des agissements de la micro-société du « milieu » et de celle de la taule ?
Parvenus à presque la moitié de l’ouvrage, on se demande alors quand Markos, de plus en plus accro au haschisch, se décidera à se ranger des voitures ? Et quelles retombées cela aura sur sa fulgurante carrière et ses premiers disques à succès ? Mais surtout comment traversera-t-il les années de l’occupation italienne, allemande et enfin, la guerre civile ?
Les derniers chapitres nous laisseront entrevoir une tout autre Markos Vamvakaris, vieillissant et malade, devenu casanier, tandis que l’on perçoit dans certains de ses propos des accents plutôt machos et homophobes. Avec en sus, une grande tendance à avoir « la grosse tête », quand bien même il est indéniable que ce dernier aura exercé une influence considérable sur la pratique du bouzouki et son rayonnement en Grèce et à l’étranger. Les paroles d’un de ses plus grands succès étaient-elles prémonitoires ? :
Je suis à bout : « Quand tout le monde aspire à vivre moi je n’aspire qu’à mourir » !!!
Virginie Girod : La véritable histoire des douze Césars
.jpg)
Dans La véritable histoire des douze Césars (éd. Perrin), Virginie Girod, historienne spécialiste de l’histoire des femmes et de la sexualité, nous convie à une exploration passionnante à la recherche d’une image « un peu plus plausible que celle qui a forgé le mythe des empereurs de la dynastie Julio-claudienne, puis flavienne ». On se doit de souligner que l’auteure aura passé pas moins de douze années à réétudier les œuvres des auteurs anciens [note] .
Dans sa préface, elle nous explique les raisons pour lesquelles elle a maintes fois préféré se référencer aux récits de Suétone (70-122 après JC), plutôt qu’à ceux « plus aléatoires » de Tacite (58-120), « qui avait tissé l’étoffe du mythe littéraire dans le but évident de plaire à l’empereur Hadrien ». Virginie Girod a donc commencé par recouper les sources textuelles et numismatiques anciennes « qui avaient tendance à considérer les douze Césars comme des monstres sadiques et paranoïaques sans essayer de comprendre ce qui avait bien pu les conduire à la folie ». Déviance qui ne cessera qu’à partir du XIXème siècle !
Mais la grande originalité de sa démarche consiste à s’appuyer largement sur les résultats des recherches archéologiques, mais surtout psycho-neuroscientifiques récentes. D’où une analyse poussée du contexte de l’enfance des douze Césars et de leurs influences, afin de déterminer si ces personnages « ont été victimes de maladies, de psychopathies, du syndrome de l’isolement dû au pouvoir ou de toute autre atrophie des structures cérébrales ». Cette approche novatrice a donc débouché sur une « enquête rigoureuse », une revisite au cas par cas, de leur histoire plus que complexe.
Le premier des douze Césars à être chronologiquement passé au crible est Jules, « cet arrogant fils de bonne famille, autoritaire, séducteur invétéré et épris de pouvoir ». Était-il depuis sa petite enfance, enclin à « devenir un homme dangereux dans une Rome en proie à la guerre civile depuis un siècle » ? L’auteure tente par petites touches, de démêler les fils du mythe, s’arrête sur les différentes phases de « sa carrière ambitieuse », comme sa conquête de la Gaule, etc. Et qu’en est-il par exemple de la soi-disant « légitimation de la dictature comme étant de son fait » ? Comme pour les onze autres Julio-claudiens qui lui succèderont, l’auteure conclue son portrait comme elle l’avait initié : par une fiction inspirée des textes anciens, « un instantané voué à réduire la part de l’imaginaire au minimum ». Pari réussi.
Le deuxième César n’est autre que Octavien, Jules l’ayant désigné comme son légataire au grand dam de Marc Antoine et de « sa putain égyptienne ». Ça commence fort ! Comment cet enfant simple et austère va-t-il se transformer en empereur Auguste ? En construisant son mythe ? Lui succèdera Tibère, ce gamin « à l’enfance de proscrit » qui n’accèdera au pouvoir qu’à l’âge de 55 ans. Naissance d’un tyran vengeur ? C’est à sa mort qu’accèdera aux honneurs, le fameux Caligula personnage lui, « décadent assumé », qui a inspiré tant d’auteurs dont Albert Camus qui, selon Virginie Girod, l’a parfaitement cerné. Dans ce chapitre qui nous laisse rêveurs, elle va tenter tant bien que mal, « de démêler les fils de sa légende noire, bien alimentée et notamment par ses talents de la mise en scène », notamment à l’appui des neurosciences.
Mais qui pourra bien succéder à Caligula ? Claude. Claude « ou la revanche d’un avorton » ! Pourquoi avorton ? L’auteur va nous expliquer d’où lui vient ce qualificatif bien peu flatteur. Nous allons donc suivre le parcours de ce « vilain petit canard, peu gâté par la nature », victime de l’hostilité de la maison familiale (exception faite de son grand-père qui lui reconnait une grande intelligence), mais surtout d’une certaine Agrippine. Comment Claude traversera les règnes de Tibère et Caligula ? Prendra-t-il sa revanche sur son enfance ?
C’est Néron qui lui succédera, « cet adolescent arrogant, artiste contrarié et glorifié par sa mère ». Après s’être attaqué à quelques clichés sur sa personne, Virginie Girod nous aidera à comprendre pourquoi après avoir « théâtralisé sa vie de luxure », il finira par être haï et abandonné de tous…
Qui héritera de la suite ? Galba, qui issu de la haute noblesse aura passé son enfance à l’ombre des Julio-claudiens, « à guetter les présages de sa grandeur future », ne devenant pourtant empereur qu’à ses 64 ans ! Sa fin ne sera pour autant pas moins tragique de celles de ses prédécesseurs, après avoir accumulé nombre de maladresses ? C’est alors au tour d’Othon d’entrer en scène. Et ce, grâce à l’amitié de son père avec Claude « le boiteux ». Mais son règne à lui ne durera que… trois mois, et nous allons en comprendre les raisons.
Place à Vitellius « aux origines incertaines, mais entré dans le "cénacle" par le biais de la flagornerie de son paternel ». Ce dernier suivra-t-il lui-même l’exemple atavique de ses devanciers « jusqu’à en écœurer les Romains » ? Aura-t-il une fin égale à son règne ?
Nous passons alors à Vespasien, « ce militaire opportuniste mais génial, issu d’une famille plébéienne » qui va inaugurer la dynastie flavienne. Passage attendu sur son fameux impôt sur l’urine, avant de savoir à qui Vespasien lèguera un empire pacifié ? A son fils aîné Titus, « cet héritier choyé » se réclamant de l’héritage des Julio-claudiens ? Mais alors, quelle sera la réaction des Latins face à ses tendances clairement homosexuelles ? Et surtout, comment fera-t-il face à la plus grande catastrophe naturelle de l’époque : l’éruption du Vésuve et ses retombées catastrophiques ? L’auteure nous laissera sur notre faim avec sa mort mystérieuse. Mais nous voilà déjà arrivés au douzième des Césars. Domitien, le frère jaloux de Titus et fils délaissé de Vespasien. Est-ce ce double héritage qui le fera devenir pour les historiographes romains « le parangon de tyran, et ce pour plusieurs siècles » ?
Ainsi se termine notre plongée vertigineuse dans le cycle des Césars qui, selon les derniers mots de Virginie Girod « dans l’ombre de femmes (mères ou sœurs) souvent trop castratrices et exigeantes en "vertus romaines", ne furent ni des héros ni des monstres et encore moins des démons (comme Néron), mais tout simplement des humains dont l’humanité a été trop longtemps diluée dans leurs mythes » … C’est tout le mérite de cet ouvrage que d’avoir rétabli bon nombre de paramètres et dont on ne serait pas étonné qu’il fasse date !
Pauline Valade : Bruno et Jean
.jpg)
« Un Paris pauvre, affamé, violent et toujours nerveux », dans lequel la vie des gens du peuple ne vaut pas grand-chose. Nous y faisons la connaissance de Bruno, notre héros, lors d’une scène assez violente, mais si commune en ces temps-là : un gamin percuté par un archer brutal. Bruno donc, un beau garçon âgé de vingt ans, (originaire de Douai et apprenti chez un artisan cordonnier) de repos ce jour-là, porte secours au gamin peureux et récalcitrant. Quelque peu dépité par l’événement, il s’en va ensuite flâner au hasard des rues de son quartier des Ecoles. Le long de la Seine, observant perplexe, ce peuple triste qui se prépare en rechignant à célébrer la Paix, lors de la grande fête imposée par le Roi, ce qui ne les réjouit guère. Et encore moins, « les jeunes de retour des Flandres ou de Saxe, vaincus désabusés que le roi Louis XV n’avait jamais remercié ».
C’est au cours de sa déambulation mélancolique que Bruno tombe par hasard sur un groupe de « chevaliers de la Manchette » (terme désignant les homosexuels de cette époque). Son regard est magnétisé par Jean, un jeune homme borgne « aux traits sévères mais à l’air doux et altier à la fois avec lequel il venait de partager un silence ». Le jour de la fête de la Paix, il s’y rend avec Rosine, une prostituée au grand cœur l’ayant pris son aile le jour de son arrivée dans la capitale et « tenant à lui, son amant devenu un grand frère, faux mari et ami de toujours ». Mais, ce jour-là, une fâcheuse aventure arrive à Rosine. Ce qui n’empêche pas Bruno de retomber sur Jean, le beau domestique quarantenaire.
C’est le début d’une histoire, un peu compliquée mais belle, belle car ce fut cette nuit-là qu’ils s’aimèrent pour la première fois. Une nuit mémorable pour eux, mais soirée de fête aux relents de cauchemar pour d’autres… Paris se réveille en effet avec la gueule de bois « On aimait le roi mais enfin, la misère était vive, impérieuse et collait aux os ». Les jours suivants, les deux amants passent de joyeuses soirées au cabaret du Roi Mouton, en compagnie de Rosine, de Lajoie (« scribe public des pauvres » au cimetière des Innocents) et du jeune tapin, Demi-lune qu’ils essayent de soustraire au trottoir. Au grand damne d’une Rosine jalouse, Jean « l’optimiste » et Bruno « l’ombrageux » sont de plus en plus complices, cherchant cependant à mieux connaitre leurs différences, tout « en tâchant d’exister dans les interstices de ce qui est permis ».
Mais dans ce Paris du Siècle des Lumières, les lumières ne brillent pas pour tout le monde ! Et surtout pas dans les bas-fonds, loin de la Cour et de la bourgeoisie d’Ancien régime, « où tout n’y était que puanteur, bassesse, saleté et grouillant de mendiants et de mouchards, les "mouches". Ces derniers étant chargés de dénoncer notamment, les personnes soupçonnées de "crimes de Sodomie" ou d’avortement clandestin, passant d’abord par la terrible prison du Chatelet, puis punis de la peine de mort ou d’un sort de pilori "pour faire honte aux condamnés" ». Dans ce contexte, Jean et Bruno parviendront-ils à s’en affranchir et vivre leur vie marginale ?
Magnifique roman tiré d’un fait historique, au sujet duquel Pauline Valade nous délivre un dernier message avant de nous quitter :
« Aujourd’hui, l’histoire de Bruno Lenoir et Jean Diot reste secrète et enfermée dans les quelques bribes de ceux qui les ont condamnés. Nul ne sait rien sur leur passion et leurs peines. Restent alors le goût des images et l’immersion forcément maladroite dans les interstices de leurs vies ».
Pas si maladroite que ça ! A signaler : on peut lire une plaque commémorative rue Montorgueil où ils furent arrêtés, inaugurée en 2014. Enfin, la superbe couverture de l’ouvrage nous livrant un détail suggestif du célèbre tableau d’Alexandre Hesse, Hommage funèbre au Titien.
Mathias Quéré : Quand nos désirs font désordre
.jpg)
Cet essai est sans doute à ce jour, le plus consistant et exhaustif qu’il m’ait été permis de lire sur la question, c’est du moins mon point de vue. D’où la longueur inhabituelle de cette recension qui n’a d’autre but que de tenter de donner un petit aperçu de tous les sujets abordés et développés.
A commencer par l’idée de prétendre que la lutte homosexuelle a pris ses racines à New-York (Stonewall) dans la nuit du 28 juin 1969, durant laquelle des femmes trans, des homo, travestis et des lesbiennes affrontèrent la police pendant des heures. Et que par ricochet, Stonewall déclencha le début des mouvements d’émancipation homosexuelle en France au début des années 70. Or, après avoir entrepris dix années de recherches poussées à fouiller dans les documents, archives privées et publiques, l’auteur va nous montrer qu’il n’en est rien. Et qu’une variété de groupes occupa le terrain avant la naissance du mythique Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) au printemps 1971, et pendant ET après la disparition du Comité d’urgence anti-répression homosexuelle (CUARH), en 1986.
« Mon travail a surtout consisté à rendre tous les aspects d’une réalité d’une histoire complexe avec ses erreurs et ses errances, afin d’écarter une vision exemplaire mais illusoire qui rendrait le présent plus terne »
.
Ceci est tout à son honneur. Son récit commence par un regard jeté sur la société française durant les XIX et XXème siècles où les pouvoir policier et judiciaire « réprimèrent à cœur joie les homosexuels », alors que le crime de sodomie fut aboli en 1791. Mais, en août 1942, Philippe Pétain réintroduisit la pénalisation de certaines relations homosexuelles. Elle fut maintenue et même renforcée en 1960, par l’amendement Mirguet - qui qualifia l’homosexualité de « fléau social », au même titre que l’alcoolisme et la tuberculose ! - et fit en France, plus de 10 000 personnes jugées coupables et condamnées à la prison, ceci jusqu’à la dépénalisation en 1982 …
Comme il se doit, Mathias Quéré commence par nous narrer l’histoire du mouvement pionnier Arcadie fondé en 1953, par un ancien séminariste mais qui resta dans la mémoire collective homosexuelle, « comme le symbole d’une organisation réactionnaire, réformiste, normative et pyramidale ». Petit saut dans le temps : pourquoi faudra-t-il attendre mai 1974, pour qu’une branche de jeunes dissidents d’Arcadie forme le Groupe de Libération Homosexuelle (GLH) ? Quelle furet son histoire et ses scissions ?
Retour à mai 68, quand le premier mouvement révolutionnaire « une étincelle » selon l’auteur, le Comité d’Action pédérastique [note] révolutionnaire (CAPR) voit le jour à la Sorbonne, seulement animé par deux individus ! Et il faudra encore attendre trois ans la naissance du FHAR « créé par des lesbiennes et des féministes ce que beaucoup de gens ne savent pas et qui propagera l’incendie homosexuel » …
Mathias Quédé va nous promener à travers son histoire et nous expliquer le mouvement en trois actes. L’intervention énergique de militants dans l’émission radiophonique de Ménie Grégoire, puis l’occupation du devant de la scène par Guy Hocquenghem et Françoise d’Eaubonne et enfin, la participation du FHAR à la manifestation du 1er mai 1971, aux côtés des féministes du MLF, etc.
L’auteur qui ne souhaite rien négliger nous rappellera également, la mésaventure de l’association religieuse David et Jonathan, souvent oubliée. Après « la mort du cygne » FHAR, l’auteur sautera les années pour en venir à la naissance des premières petites annonces dans Libération, où sont entrés plusieurs anciens militant.es du FHAR. Puis les évènements qui suivirent, la semaine homosexuelle au cinéma Olympic en 1977, la première grande marche autonome à Paris avec le slogan : « Le ghetto c’est foutu, les pédés sont dans la rue », etc. Mathias Quéré élargit son champ sur la sur la réalité quotidienne des homosexuel.les à l’époque à Paris et leur combat contre la répression. Il nous livre ensuite des témoignages venus de province où « les homosexuel.les sont éparpillés sur le territoire, refoulés dans des ghettos et crèvent de solitude ».
On avance dans le temps, tandis que l’auteur pointe du doigt les divergences qui se font jour vers la fin des années 70. Entre les groupes féministes et les lesbiennes, entre les féministes et les groupes de garçons homos, mais aussi entre ces derniers et les lesbiennes qui refusent de « jouer le rôle de faire valoir et subir la misogynie dans les groupes mixtes ».
Et quid de leurs rapports avec les organisations de gauche et d’extrême-gauche ? Nous allons être surpris par les premières positions du PCF et de la CGT, mais aussi par celles des trotskistes, maoïstes et mêmes anarchistes. Encore autant de témoignages édifiants à découvrir. Comment réagir alors ? Nous verrons ici les GLH s’immiscer de force dans les grandes marches antimilitaristes, en solidarité avec les soldats emprisonnés (on peut lire à ce sujet, Contingent rebelle de Patrick Schindler), antinucléaires, au sein des Comités Prison. Passage intéressant sur la dimension européenne sous le slogan issu du FHAR « Prolétaires de tous les pays caressez-vous » !
Changement de ton à partir de 1979 où une répression musclée, policière et de l’extrême-droite sévie dans les lieux culturels parisiens. Quid de la perception des homosexuels.le au sein de l’Education nationale ? Là encore nous ne laisserons pas d’être ébahis ! C’est en réaction que font le créer les Comités Homosexuels d’Arrondissement (CHA) dont certains membres vont par provocation se présenter aux élections locales (non sans quelques réticences) pour affirmer leur visibilité.
On est une fois encore surpris par l’étendue du travail de Mathias Quéré qui nous entraîne dans les aventures des revues Masques et Gai Pied, des radios pirates ou de l’Association des Médecins Gais (AMG). Devant les nouvelles attaques juridiques, c’est au tour des Comités Urgence Anti-répression homosexuelle (CUARH) de voir le jour ayant pour objectif majeur de lutter pour l’abrogation de l’article 331-alinéa 3, toujours en vigueur et sa longue agonie entre les deux Chambres ... L’auteur s’arrête longuement et sans concessions sur la problématique des lesbiennes « exaspérées par l’invisibilité où elles sont condamnées dans les orgas féministes et homosexuelles garçons » et leur mobilisation pour trois cas vécus par des lesbiennes voulant obtenir la garde de leurs enfants.
L’approche des élections présidentielles de 1981 verra-t-elle jaillir un espoir ? C’est ici que nous allons assister à la mobilisation homosexuelle « donner de la voix contre une législation homophobe ». Arrêt sur « la plus grande manifestation jamais vue en Europe » qui rassemble à Paris, plus de 15.000 homosexuels et gay-friendly (pour l’anecdote sur la photo page 106, on aperçoit un Rat noir (entre le lapin et le sarouel) dont le Gai Pied fera sa Une…). Quid une fois François Mitterrand élu le 10 mai 1981 ? Sept ans de bonheur, comme le titre Gai Pied ? Pas si sûr, la suite va nous le prouver… Mais auparavant, l’auteur va nous promener à travers les dernières heures du CUARH (à découvrir) et le long de la première Pride, organisée en 1982. Début d’une marchandisation de l’homosexualité ? Mais aussi nous faire découvrir les premières heures de Fréquence gay, la première radio homosexuelle à émettre 24/24, 7 jours sur 7. Et en province quels sont alors ces espaces associatifs qui fleurissent un peu partout ? Arrêt sur Lesbia, le magazine lesbien, les bars gays qui se multiplient à Paris comme en province et les premiers saunas ? Hauts lieux à risques ?
Mais l’euphorie des premiers jours du socialisme n’a qu’un temps. Quels vont être les retours de bâton ? Quels sont ces milliers de policiers qui défilent à Paris en juin 83, hurlant des slogans antisémites, homophobes et qui ratonnent les immigrés sur leur passage ? Pourquoi ces rafles dans bars gays de l’Hexagone ? Au passage quel est ce nouveau « bloc homosexuel de droite » qui sort du tableau ? Et comme par hasard, pourquoi l’affaire du Coral éclate-t-elle à ce moment précis ? Mathias s’y s’arrête longuement avec une attention juridique toute particulière, essayant de remettre quelques pendules à l’heure et de comprendre les raisons de la confusion qui va en résulter. Cependant le pire est encore à venir avec les débuts de l’épidémie du sida dans le monde occidental, qualifiée de « cancer gay » !... Comment va réagir le corps médical ? A quand les premiers dépistages, les premiers traitements ? Une fois les populations hétérosexuelles, hémophiles et toxicomanes touchées, pourquoi l’image première d’une « punition divine » pour les homosexuels va-t-elle prédominer dans l’opinion - y compris dans les milieux homos ? C’est en farfouillant dans les archives que Mathias va tenter de trouver les réponses à ces questions, mais aussi aux suivantes : à quelle date, la recherche, la direction de la Santé et les militants gays vont-ils réagir ? Pour quelle mobilisation ? Quid à l’international, tandis que l’épidémie progresse et que les morts se multiplient à partir de 1984 ? Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu’une première association de malades d’envergure comme AIDES voit le jour ? Pour que la première permanence téléphonique bénévole soit opérationnelle et les premiers traitements commencent à agir après l’hécatombe ? Enfin, faudra-t-il attendre 1989 et la naissance d’Act Up Paris pour que le combat politique homosexuel ressurgisse avec le début d’une autre histoire ?
Celle de ce livre qui fera sans doute référence s’achève, elle, en 1986. Dans l’épilogue, Mathieu Quéré nous met en garde et nous rappelle judicieusement que c’est justement cette année-là qu’est né le magazine d’extrême-droite Gaie France (avant d’être interdite en 1993), « alors que les idées d’extrême-droite prolifèrent toujours plus dans une communauté qui n’en a que le nom. Et que faire à présent que l’extrême-droite est aux portes du pouvoir et que les attaques fascistes se multiplient » ?
On ne saurait mieux conclure !
Patrick Schindler, groupe de Rouen, ancien militant du FHAR et d’Act-Up Paris
Mais voilà un passager clandestin
Groupe de Rouen
Juillet, rat noir, qu’est-ce que tu lis pour les vacances ?
Le Rat noir a lu Guy Pique
C’est le printemps, avril, le rat noir est de retour.
Sur le calendrier du rat noir, au mois de février, les jours s’allongent peu à peu
"Monsieur Janvier, c’est des livres francs" exige le rat noir.
Décembre, le rat noir a rempli sa hotte
A Athènes, Exarcheia est toujours bien vivante : La Zone, un nouveau lieu de rencontre libertaire vient d’ouvrir ses portes !
Le rat noir fera craquer les pages blanches, octobre tiendra sa revanche
Les livres portent déjà les couleurs de septembre et l’on entend, au loin, s’annoncer le rat noir
Le raout du rat (noir) en août
Les livres du rat noir de juin, les livres du rat noir de juin
Mai, mai, mai, Patrick mai... Mai, mai, mai, rat noir !
"Nous roulerons comme les écrivains roulent Ni riches, ni fauchés... Viens être mon rat noir d’avril Viens, nous allons briser toutes les règles"
Mars : "Un pas, une pierre, un rat noir qui bouquine..."
Février de cette année-là (2024) avec le rat noir
Janvier, une nouvelle révolution... terrestre*. Et le rat noir, toujours là.
Décembre : pas d’hibernation pour le rat noir.
Novembre, le rat noir toujours plongé dans des livres.
lectures d’octobre avec le rat noir
Sœurs ensemble, tu n’es plus seule !
Les vendanges du rat noir. Septembre 2023, un bon cru...
Le rat noir est "in" pour ce mois d’août
Lunettes noires pour un rat noir, voilà juillet.
Gay Pride d’Athènes 2023 en une seule photo !
Le rat noir répond à l’appel de juin
En mai le rat noir lit ce qui lui plait (mai 2023)
En avril le rat noir ne se découvre pas d’un livre
Athènes . Rendez vous féministe et solidaire était donné le 8 mars
En Arès, le rat noir hellénophile attend le printemps.
Hommage au philosophe, René Schérer
Pour un mois de février à ne pas mettre un rat dehors...
Le rat noir a fait au gui l’an neuf : merveille : son œuf mensuel.
Grèce. Un Rom de 16 ans tué par un policier pour un vol à 20 €
Pour finir l’année avec le rat noir
Commémoration du 17 novembre 1973, hier à Athènes
Ballade en novembre pour le rat noir
Finies les vendanges en octobre, le rat noir fomente en tonneau
"C’est en septembre que je m’endors sous l’olivier." rêve le rat noir
Coming août, voici le rat noir.
Le rat noir lit à l’ombre en juillet
Gay Pride Athènes 2022
En mai, le rat noir lit ce qui lui plaît.
En avril, le rat noir ne se découvre pas d’un livre.
Encore un peu du rat noir pour mars
Le rat noir de mars
Vite, le rat noir avant que mars attaque...
Février de cette année-là, avec le rat noir.
Une fin de janvier pour le rat noir
deux mille 22 v’là le rat noir
Le Rat Noir de décembre...
Un rat noir de fin novembre...
Début novembre, le rat noir est là
Octobre, nouveau message du rat noir
revoilà le rat en octobre
Le message du rat noir, fin septembre
La rentrée du rat noir
La fin août du rat noir
Mi-août, voilà le rat noir !
Le rat noir, du temps de Jules au temps d’Auguste
Le rat, à l’ombre des livres
Interview de Barbara Pascarel
Le rat noir, fin juin, toujours le museau dans les livres
Un bon juin, de bons livres, voilà le rat
On est encore en mai, le rat lit encore ce qui lui plait
En mai le rat lit ce qui lui plait
Fin avril, le rat noir s’est découvert au fil de la lecture
Un rat noir, mi-avril
Une nouvelle Casse-rôle sur le feu !
Qu’est Exarcheia devenue ?
V’là printemps et le rat noir en direct d’Athènes
Le rat noir de la librairie. Mois de mars ou mois d’arès ? Ni dieu ni maître nom de Zeus !!!
Librairie athénienne. un message du rat noir
Le rat noir de la librairie athénienne. Février de cette année-là.
Le rat noir d’Athènes mi-janvier 2021
Le rat noir de la bibliothèque nous offre un peu de poésie pour fêter l’année nouvelle...
Volage, le rat noir de la bibliothèque change d’herbage
Octobre... Tiens, le rat noir de la bibliothèque est de retour...
Le rat noir de la bibliothèque pense à nous avant de grandes vacances...
Maurice Rajsfus, une discrétion de pâquerette dans une peau de militant acharné
Juin copieux pour le rat noir de la bibliothèque.
Juin et le rat noir de la bibliothèque
Mai : Le rat noir de la bibliothèque
Séropositif.ves ou non : Attention, une épidémie peut en cacher une autre !
Mai bientôt là, le rat de la bibliothèque lira ce qui lui plaira
Toujours confiné, le rat de la bibliothèque a dévoré
Début de printemps, le rat noir de la bibliothèque a grignoté...
Ancien article Des « PD-anars » contre la normalisation gay !
mars, le rat noir de la bibliothèque est de retour
Janvier, voilà le rat noir de la bibliothèque...
Vert/Brun : un "Drôle de couple" en Autriche !
Ancien article : Stéphane S., le poète-philosophe libertaire au « Sang Graal »
Algérie : l’abstention comme arme contre le pouvoir
Décembre 2019 : Le rat noir de la bibliothèque
1er décembre, journée mondiale contre le sida : les jeunes de moins en moins sensibilisés sur la contamination
A Paris, bientôt de la police, partout, partout !
Les Bonnes de Jean Genet vues par Robyn Orlin
N° 1 du rat noir de la bibliothèque
En octobre et novembre le ML avait reçu, le ML avait aimé
Razzia sur la culture en Turquie
Ces GJ isolés qui en veulent aux homos !
Service national universel pour les jeunes : attention, danger !
Vers l’acceptation de la diversité des familles dans la loi ?
Une petite info venue de Grèce
Le philosophe à l’épreuve des faits
La Madeleine Proust, Une vie (deuxième tome : Ma drôle de guerre, 1939-1940)
Loi sur la pénalisation des clients : billet d’humeur
Les anarchistes, toujours contre le mur !
Le Berry aux enchères
1 |
le 5 mai 2025 17:20:17 par Stéphane S. |
Cher rat noir,
"Quand nos désirs font désordre" m’a l’air passionnant...
Merci pour tous ces bons tuyaux,
Au poil !!!
Stef
2 |
le 5 mai 2025 17:22:40 par Corinne S. |
Cher Rat noir,
Merci pour la très belle photo de la toile du Caravagio au musée des Beaux Arts de Rouen. Il illustre à merveille la recension de Bruno et Jean, je suppose que c’était fait exprès ???!!!
Amicalement,
Corinne
3 |
le 7 mai 2025 19:33:05 par Martine |
Très mignonne la vidéo en fin de rubrique. Et tellement vraie !
Merci
Martine
4 |
le 9 mai 2025 11:30:41 par max |
Même si nos désirs font désordre, en mai, fais ce qu’il te plaît. A bientôt, je l’espère, cher Patrick pour d’autres aventures littéraires